|
Historique : 1909 - 1968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1909 : Ce gros bourg, qui à l'origine se
nommait Argenton-les-Deux-Églises puis Argenton-les-Deux-Rivières sous la
révolution, sort doucement de l'anonymat quand M. Doc et plusieurs
agriculteurs du coin fondent la laiterie coopérative d'Argenton-l'Eglise.
M. Doc, qui possède un établissement de fournitures pour laiteries et
fromageries et originaire du hameau de "Crêle", devient le premier
Président. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1910 : Vers la fin de l'année, la laiterie,
placée en la riante vallée de l'Argenton, commence à
fonctionner. L'affaire prend rapidement de l'extension, car au vu de sa
situation, tout au nord du département, elle est la seule implantée
au-dessus de Thouars, les laiteries de Massais et de St-Varent étant plus
au sud. Il y a bien quelques petites laiteries privées comme celles de
Taizon ou les Iles de Bagneux, mais elles sont sans grande conséquence
pour elle. MM. Constant Renaudin,
Auguste Prisset, et les employés à l'intérieur de l'usine reçoivent de
plus en plus de lait que leur apportent les laitiers MM. Roger Bodin,
Pierre Fenneteau, et Alphonse Hérissé entre-autres.
Cette même année, le constructeur "Escher Wyss." installe un système réfrigérant
fonctionnant au CO2 d'une puissance de 7.500 frigories, pour la
réfrigération du lait.
1913 : En ce mois de février, la laiterie remporte pour ses beurres, la
médaille d'argent au concours général agricole de Paris, ainsi qu'en 1914. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1914-18 : La guerre comme partout a
mobilisé les hommes. De nouveaux employés arrivent tel M. Georges Baudouin
comme chauffeur. Une laitière Célestina Gabiller parcourt les fermes le
long de l'Argenton.
En 1918, l'établissement fonctionne à
l'aide d'une chaudière cylindrique horizontale, d'un réfrigérant plat de
1000 l par heure, deux pompes à eau, une pompe à babeurre, deux pompes à
crème, une pompe à petit-lait, une machine frigorifique. La laiterie
fonctionne de 5 h à 16 h.
1920 : M. Adrien Guédon, le beurrier, à
reçu pour l'année 4.623.986 litres de lait qu'il a transformé en excellent
beurre.
1926 : M. Isidore Peltier, le contrôleur, a
vu passer dans ses bacs quelques 6.147.130 litres de lait entier qui ont
produit 264.144 kilos de beurre.
1932 : L'entreprise, qui a atteint cette
année le cap des 7 millions de litres et que préside M. Piard, reçoit une
belle récompense à ses efforts en décrochant une médaille d'Argent à
Paris.
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
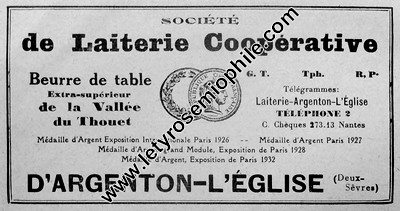
1934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1935 : La laiterie traite en moyenne 25.000
litres par jour. Toujours fidèle a son poste, Adrien Guédon, devenu
chef-beurrier, est honoré par un diplôme pour ses 15 ans de services.
1939 : Le 26 Février, lors de l'assemblée
générale, M. H. Piard est réélu président pour 3 ans. Le bureau se compose
de cette manière : Les vice-présidents sont MM. R. Piloteau, R. Poupelin,
C. Olivier et J. Dallerit,
le trésorier M. C. Gaury, et le secrétaire
M. H. Guérineau complètent le bureau. Avec un chiffre d'affaires de
7.889.328 frs pour une collecte de 7,6 millions de litres, la laiterie
prouve sa rentabilité. Une autre médaille d'Argent lui confère une
belle renommée.
En 1944,
M. Protteau Louis est élu président pour diriger la laiterie, aidé de son
chef-comptable M. Milliasseau Edmond.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
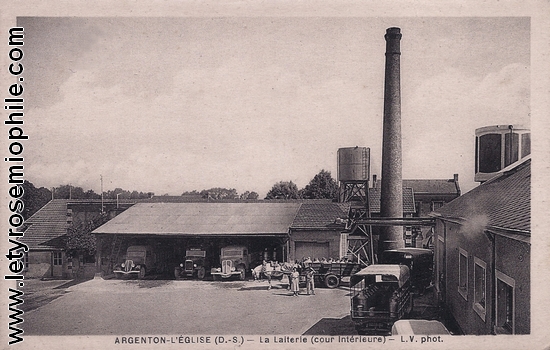 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1952 : Les 8 millions de litres de lait
sont atteints sous la présidence, depuis quelques années, de M. Protteau,
le maire de Bouillé-Loretz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En 1953, les races de vaches sont très
diverses ; cependant on trouve un peu plus de Maine-Anjou. Comme la
laiterie ne paye pas à la matière grasse, les Hollandaises commencent à
s'implanter.
Placée aux confins des Deux-Sèvres, en
limite du Maine-et-Loire, la laiterie a beaucoup plus d'affinités, avec ce
département, en ce qui concerne la qualité du lait. Ses rendements sont à
peu près les mêmes, mais malheureusement éloignés des laiteries de la
Gâtine ; ils sont particulièrement compromis l'été à cause d'une assez
forte acidité qui provient surtout, comme dans bien des laiteries, du
manque de soins apportés au lait à la ferme, cependant la situation
s'améliore car les sociétaires font des efforts.
|
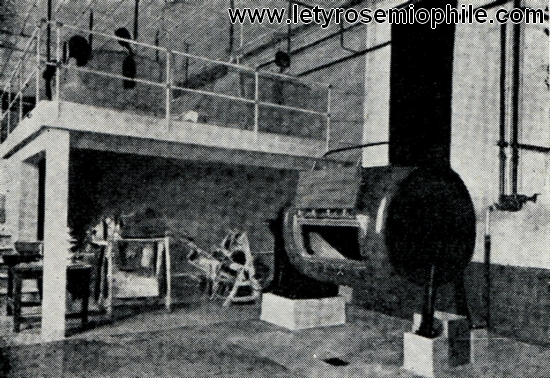 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En 1955, la laiterie est classée
dans les plus importantes des Deux-Sèvres pour la quantité de lait traité,
elle traite 9,5 millions de litres de lait.
Cette quantité est amenée par 16 courtiers.
La zone de ramassage est assez condensée puisque les tournées les plus
longues ne dépassent pas 40 kilomètres (départ laiterie et retour à
celle-ci). Ce gros avantage permet de payer sensiblement le lait aussi
cher que ses voisins.
Le lait est payé au litre, la majorité
des sociétaires, comme dans toute la région, étant opposée au paiement à
la matière grasse. Avec les sous-produits la laiterie fabrique de la
caséine, de la poudre de lait, des fromages divers, gruyères pasteurisés,
etc.
1959 : On entreprend la modernisation de
l'usine. Du matériel est importé d'Allemagne pour l'équipement de la
beurrerie en pasteurisateurs. Les antiques barattes sont remplacées par un
butyrateur qui sans aucune manutention peut produire 700 kilos de beurre à
l'heure. On installe trois nouvelles écrémeuses. Deux débitent 5.000 litres à
l'heure et la troisième 3.000 litres.
1961 : Le nouveau président est M. Georges
Doublée.
1963 : L'entreprise traite presque 11
millions de litres de lait. On la considère comme la troisième laiterie du
département. Une nouvelle chaufferie, utilisant le mazout comme carburant,
est mise en service.
1964 : forte de ses 850 sociétaires, la
coopérative laitière dépasse les 40.000 litres journellement. La laiterie
est considérée comme la troisième du département. La collecte
s'étend sur 13 communes qui sont : Argenton-l'Eglise, Mauzé-Thouarsais,
Bouillé-St-Paul, Cersay, Bouillé-Loretz, Bagneux, St-Martin-de Sanzay,
Brion-près-Thouet, Louzy, Ste-Verge, St-Cyr-La-Lande, Tourtenay, et
St-Martin-de-Mâcon, plus 3 communes du Maine-et-Loire : Antogny,
Le-Puy-Notre-Dame et St-Macaire-des-Bois.
Chaque matin 15 laitiers font la tournée.
18 personnes s'emploient à la fabrication du beurre, de la caséine ou à la
mise du lait en sachets. On effectue le premier ramassage de lait de
chèvre qui est ensuite envoyé à St-Varent.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Pour produire le beurre ''Etoile d'Argent",
les besoins en eau sont importants. La laiterie possède deux puits d'une
réserve de 120m2. L'eau est détartrée avant de passer dans un appareil de
traitement aux rayons ultra-violet. Argenton est la première en
Charente-Poitou à être équipée d'un tel appareil. On consomme en moyenne
120 à 130m2 d'eau par jour. Un système de pompage automatique est installé
sur la rivière l'Argenton.
De plus un nouveau séchoir avec ensachement
automatique a fait son entrée à la caséinerie. C'est une activité
secondaire car la plupart du lait écrémé pasteurisé s'expédie à St-Loup
pour la fabrication du lait en poudre. Seuls les mauvais laits sont
caséinifiés ici, soit 3.900.000 litres par an.
Toujours pour cette année et depuis le
printemps, la laiterie fabrique des sachets de lait pasteurisé et
conditionné à 36% de matières grasses par litre. La production atteint 500
sachets par jour et est en progression constante. Elle espère arriver à
2.000 sachets quotidiens à la fin de l'année 1964.
Tout respire le neuf ici. Le président
Doublée a fait ériger des bureaux vastes et clairs pour la comptabilité,
la direction et le laboratoire. On a construit une chambre froide avec des
bacs à eau glacée, d'une contenance de 35m2 et pouvant stocker 10 tonnes
de glace.
La haute cheminée, qui se dressait dans le
ciel argentonnais, ne fumera plus. Elle est démontée brique par brique par
une entreprise locale.
Le conseil d'administration est réélu. Il
se compose ainsi : Président : Georges Doublée ; vice-présidents : MM.
Gilbert Bernard et André Brosset ; secrétaire : Robert Brunet ; trésorier
: Marcel Godin. et toujours M. Millasseau comme directeur.
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
1966 : L'état de santé de M. Millasseau,
s'aggravant depuis quelque temps, le contraint à cesser son activité. Au
mois de septembre, M. André Geairon vient prendre la direction de
l'entreprise. Il était auparavant le dirigeant de la laiterie de
Voultegon.
1967 : L'ère des fusions entre grandes laiteries est
néfaste aux moyennes et petites entreprises. Le projet d'union qui se
prépare entre les laiteries coopératives de St-Loup et St-Varent signe
l'arrêt de mort d'Argenton.
1968 : En Janvier, le directeur M.
Geairon quitte l'établissement. Après plus d'un demi-siècle d'existence la
laiterie d'Argenton-l'Eglise disparaît à son tour. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996 : On peut voir encore, la belle
cheminée de l'ancienne laiterie qui abrite l'entreprise de bâtiments "Bati-pose".
Maintenant, les locaux sont désormais la propriété de la commune et
servent de local technique.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rédaction et mise en page ED - © letyrosemiophile.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()