|
Historique : 1889 - 1963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le Bourdet est une petite
localité du canton de Mauzé-sur-le Mignon, située au sud du département, aux
portes de ce marais, devenu en 1979 le parc naturel du Marais Poitevin.
Le 22 novembre 1889, le minuscule village du Bourdet,
situé le long des rives de "la Courance'', va entrer dans l'histoire de
l'épopée laitière en créant la première laiterie coopérative des
Deux-Sèvres. Ayant à leur tête, M. Jean Moinet, 72 "braves" s'associent dans
cette toute nouvelle aventure, comme M. Moullier, et surtout celui qui en
fut l'instigateur et la cheville ouvrière pendant 25 ans M. Henri Grizeau,
"le père Henri", comme l'appelaient respectueusement tous les sociétaires.
C'est aussi la seconde laiterie de l'Association Centrale des Laiteries
Coopératives des Charentes et du Poitou, dont elle a toujours fait partie.
La "laiterie de la Courance" est
située à 3,5 km de la gare d'Epannes, sur la voie ferrée reliant Niort à La
Rochelle.
La construction débute en 1890, cinq pièces principales
constituent le bâtiment : la salle des machines, l'atelier de fabrication en
moellon enduit, la chambre d'emballage, le bureau du directeur-comptable et
le hangar. La laiterie s'équipe aussi d'une machine à vapeur et commence la
fabrication du beurre sous la direction de M. Alcide Mangou qui a sous ses
ordres un chauffeur et le beurrier M. Victor Lorioux. Un bâtiment annexe est
construit pour abriter une porcherie.
L'année 1891 voit
l'agrandissement de la beurrerie suite à la production de lait qui augmente
d'année en année dans le secteur du Marais. Le ramassage du lait s'effectue
chaque matin par les laitiers en charrettes à roues de bois, tirées par les
chevaux, ils passent ainsi de ferme en ferme mesurant le lait livré avec un
décalitre gradué, puis versent le lait dans des grands bidons de 200 litres
pour les conduire vers la laiterie et les livrer sur un quai. Chaque
charrette transporte environ de quatre à six bidons en acier étamé.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
1896
: Sept ans après sa création, la laiterie coopérative compte maintenant
550 sociétaires. L'engouement de la réussite présente, a vite balayé le
scepticisme du départ de nombreux paysans.
1898
: Le 1er mai, le Bourdet devient la première laiterie à proposer à ses
adhérents, le paiement du lait d'après sa richesse. ll en résultera une
répartition plus équitable du produit net et la disparition de
la fraude. Chaque sociétaire sera payé proportionnellement au beurre
produit par son lait. On embauche à cet effet, un contrôleur.
C'est hélas un échec, au bout d'un an, les paysans préférant la quantité
de lait fourni, que le paiement à la richesse butyreuse. M.
Alcide Thomäs reste cependant à son poste.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
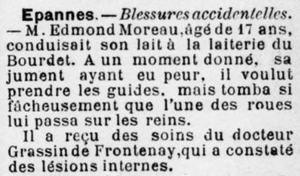
22 octobre 1900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le
22 novembre 1905, l'engagement des sociétaires arrivant à expiration, la
société se réduit à 132 membres, par suite du départ d'un grand nombre
d'adhérents, notamment ceux du village de "Rochénard" qui vont
grossir les rangs de la laiterie d'Épannes, coopérative créée en 1899. Le
président, M. Moinet et les vice-présidents MM. Eugène Seigneuret et
Servant-Picard déplorent cette désertion. Avec
cette défection inattendue, le troupeau des laitières n'est plus que de
432 bêtes.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
1909 : D'après les chiffres communiqués par le président de la
coopérative, la laiterie de Le Bourdet reçoit 70.000 litres environ de
lait mensuellement, c'est à dire 840.000 litres à l'année.
1906
: M. Moinet est réélu à la tête du conseil. Aux vice-présidences, on
trouve MM. Seigneuret et Louis David, père. M.
Alphonse Dazelle devient le trésorier et M. Henri Grizeau, le secrétaire.
Un
nouvel employé fait son entrée à la laiterie. C'est M. Alfred Barbottin.
1907
: Le 29 Décembre, après dix huit ans de fidélité ét de dévouement à sa
laiterie, le président M. Moinet passe la main. M. Henri Grizeau est
sollicité par ses collègues du conseil, pour le remplacer.
1909
: Le matériel, utilisé depuis la fondation, a besoin d'être renouvelé.
Écrémeuses et barattes modernes sont installées. Par contre, les moyens
financiers de la coopérative étant insuffisante pour l'achat d'une
machine frigorifique, la laiterie continue d'acquérir la glace dont elle
à besoin à la fabrique de l'Association Centrale de Surgères.
1910
: Un
atelier de fabrication de la caséine est construit pour permettre une
meilleure valorisation du lait écrémé, qui avant était destiné à
l'alimentation des porcs et le bétail des sociétaires .
L'entreprise reçoit environ 70.000 litres de lait par mois.
Depuis
Avril, les sociétaires ne reçoivent plus qu'un dixième de petit lait, le
restant est converti en caséine, dans l'atelier construit
à cet
effet au début de l'année.
Le personnel de la laiterie comprend 3 ramasseurs payés
chacun 2 francs par jour. A l'intérieur de l'usine il y a le comptable, le
beurrier et un chauffeur. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le
beurre se négocie à Paris, par mandataires, au prix de 2,85 fr le kg. Le
litre de lait payé aux producteurs est de 0,115 frs, en moyenne.
La
laiterie arrête la porcherie. L'emploi du petit lait à la caséinerie et
les mauvaises odeurs, ont contribué à sa suppression.
Un jour, une mauvaise surprise attend le directeur. Il constate
que le niveau d'eau, dans le puits, n'a pas monté depuis hier soir. On a
dû tomber sur une petite poche. Le géologue se serait-il trompé?
M.
Augereau (le rappelle au téléphone et lui décrit la situation. L'éminent
technicien explique que la foreuse a probablement colmaté, sans le
vouloir, l'arrivée de l'eau. Il suffit d'extraire le bouchon d'argile qui
obstrue, à l'aide d'une pompe aspirante. Effectivement après cette
opération, l'eau surgit et remplit le puits. Les analyses du laboratoire
confirment la pureté de la source. M. Augereau et M. Edmond Morisset, le
président, sont enfin rassurés.
1913
: La collecte annuelle se monte à 872.466 litres. La production de beurre
a atteint un poids de 42.274 kilos.
Le
président M. Grizeau est réélu.
1917 : Le matériel utilisé de laiterie est en mauvais état du fait qu'il
existe depuis la création de cet établissement en 1890. A la fabrication
du beurre est venue se joindre celle du fromage, puis la préparation de
lait pasteurisé.
1922
: Invoquant son âge, M. Grizeau ne se représente pas à la présidence. Les
administrateurs élisent M. Servant pour lui succéder.
La laiterie coopérative du Bourdet obtient
diverses médailles pour son beurre extra fin, à Paris en 1900, 1910 et
1932, Milan en 1911, Strasbourg en 1923.
|

Camembert "Le Fameux". |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1927
: Lors du Concours Agricole de Paris, la coopérative est récompensée par
une médaille de bronze pour son beurre.
1929 : La production est
de 4.000 litres de lait par jour l'été, et de 2.000 litres l'hiver. On y
fabrique seulement du beurre et de la caséine lactique. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Camembert "Le Délicieux". |
1930
: M. Malisset est le nouveau président.
1932
: Une médaille d'argent, à Faris, récompense les efforts de la laiterie.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
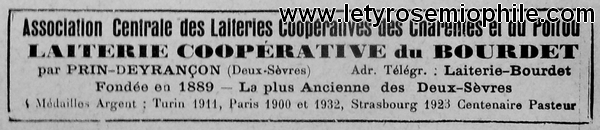
1934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1943
: M. André Augereau arrive à la direction de l'entreprise. Il lance
aussitôt l'atelier de fromagerie. Malheureusement pendant cette sombre
période, la laiterie ne peut fabriquer que des fromages à 20% et même 0%
de matières grasses, les allemands récupérant la crème pour eux.
1945
: La coopérative augmente son nombre de sociétaires. La laiterie de
Prin-Deyrançon, dans l'impossibilité de payer ses producteurs, demande de
l’aide au Bourdet. Les deux présidents se mettent d'accord, en trois
jours. La
laiterie coopérative éponge les dettes de sa voisine et absorbe les
sociétaires de Prin-Deyrançon.
1949
: Au mois de Mars, le directeur M. Augereau quitte la laiterie. M. Louis
Ovid, l'ancien dirigeant de la laiterie de Prin-Deyrançon lui succède. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Fromage "Le Roi des Maigres",
étiquette
emblématique et symbolique de la période 1939-45. |
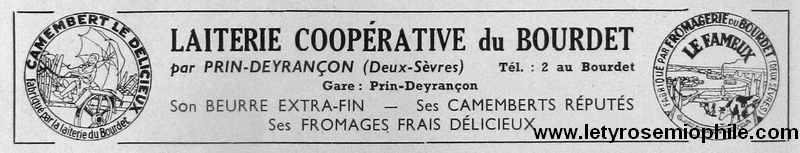
Pub de 1951 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1952
: La laiterie a collecté pour cette année 1,6 millions de litres. Elle
produit du lait de consommation pour la ville de Niort.
Un nouveau quai de
réception est créé, ainsi qu'un laboratoire d'analyses, puis la
construction du garage et d'un transformateur électrique. Le matériel à
été modifié quant aux écrémeuses et à la baratte elles sont d'un modèle
nouveau. Les fabrications se poursuivront encore une dizaines d'années.
Afin
de respecter la législation en vigueur, concernant la livraison
obligatoire en bouteilles de lait dans les villes de plus de 20. 000
habitants, la laiterie contracte un emprunt de 5 millions de francs,
auprès de la Caisse Nationale de Crédit Agricole (la CNCA). Une superbe
chaîne d'embouteillage est installée.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1954
: Un deuxième emprunt de 6 millions de francs est accepté par le même
organisme bancaire.
Cette année là, la laiterie se tourne résolument
vers le slaits de consommation, et est devenue le principal fournisseur de
la ville de Niort en lait pasteurisé certifié.
Une propagande très
suivie a conduit tout naturellement au paiement à la qualité en
surveillant particulièrement :
- l'alimentation rationnelle des vaches laitières
- la propreté et la conservation des laits à l'étable
- la collecte deux fois par jour en été
- un contrôle et examen bactériologique des laits de chaque producteur
Cela assure en toute saison un produit ne dépassant jamais 18 à 20°
Dornic et parfaitement propre à la pasteurisation.
Sous l'active et
féconde direction de M. Ovide, des recherches très poussées sur la
conservation des laits pasteurisés l'a conduit à utiliser le
pasteurisateur-stérilisateur Laguilhar véritable révolution dans la
pasteurisation.
L'appareillage est complété par une chaîne d'embouteillage Remy et deux
compresseurs de 25.000 frigories chacun assurant le froid si nécessaire
dès que l'on borde les laits de consommation.
|
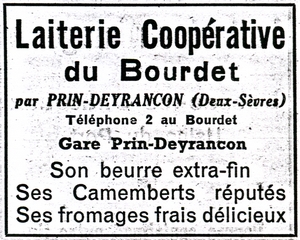 |

La vendeuse de fromages, de profil. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Carré de l'Ouest "Le Messager". |
1955
: On s'aperçoit dans le passif du bilan de la laiterie, que le premier
prêt figure toujours. La coopérative est dans l'impossibilité de couvrir
l'amortissement. Son compte d'exploitation est en déficit. La Caisse
Nationale a agi avec légèreté, en accordant ce deuxième crédit, sans bien
vérifier où en était le précédent.
1956
: "Vieille par sa date, toujours jeune par ses réalisations !" telle est
la devise de la laiterie coopérative du Bourdet dont le souci majeur reste
de donner toujours satisfaction à sa nombreuse clientèle.
La quantité de lait ramassé pour l'année se monte à 1,44 millions de
litres. Le Bourdet est considérée comme une coopérative à faible volume de
lait, en comparaison à ses voisines (Coulon : 5 millions,
Mauzé-sur-le-Mignon : 3 millions).
La
coopérative, présidée par M. Bonneau, déjà durement éprouvée, subit une
nouvelle crise grave due à la pénurie d'essence imposée par le
gouvernement, suite à la fermeture du canal de Suez et à sa
nationalisation, par le président égyptien, le colonel Nasser.
Le
rationnement décrété par l'État, touche tous les français et
principalement les industries. La laiterie n'a droit qu'à 40 litres de
carburant par camion et pour un mois. ll est difficile, dans ces
conditions, d'effectuer la collecte entièrement et journellement.
De
nombreuses petites laiteries se retrouvent au bord de la fermeture. Le
Bourdet en fait partie.
|

Petit camembert "Le Bourdet". |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L'Association Centrale des Laiteries Coopératives du Poitou-Charentes,
favorable aux fusions des exploitations laitières de peu d'envergure,
convoquent, en Assemblée Générale Extraordinaire, les sociétaires du
Bourdet et d'Épannes, en vue de la fusion de ces deux coopératives avec
celle, plus importante, de Coulon.
Contrairement à ceux d'Épannes et contre toute attente, les producteurs du
Bourdet refusent le regroupement avec leurs homologues coulonnais.
C'est un risque énorme, qu'ont pris les adhérents. On entendra même dire
que la poursuite, en solitaire, de l'aventure de la laiterie, est
périlleuse et suicidaire. Mais il faut respecter la voie démocratiquement
choisie par les sociétaires. Et comme dit le proverbe : "Qui vivra,
verra !".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Fromage mi-chèvre du Bourdet. |

Fromage de chèvre du Bourdet. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le 21 Janvier
1960, comme chaque matin, un camion
de la laiterie chargé de bouteilles de lait assure la distribution dans
les dépôts de quartiers, de la ville de Niort. Comme à l'accoutumée, le
chauffeur M. Emile Vandé, avec à ses côtés M. Gaston Gravat, font tous
deux la tournée. Dans chaque quartier, les dépositaires règlent les
laitiers en espèces. Comme d'habitude, M. Vandé range les billets de
banque, dans une sacoche qu'il dépose sous son siège. La matinée se passe
normalement, jusqu'à la rue Gambetta. Là, au dépôt du "Bon Accueil'', en
ressortant, les deux hommes constatent, avec effroi, la disparition du sac
en cuir, contenant la recette estimée à un million de francs.
La police
ouvre une enquête. Le
ou les malfaiteurs devaient être très au courant des habitudes de
règlement des dépositaires. En effet, ces derniers ne payent que tous les
quinze jours. De plus, par sécurité, M. Vandé dissimule la sacoche dans
une boîte en métal, elle-même à l'abri des regards, sous la banquette du
conducteur. Les
recherches pour retrouver le ou les coupables du vol restent vaines. Un
comité de la laiterie alla jusqu'à consulter une célèbre voyante, mais hélas sans succès. On ne retrouvera jamais les auteurs du vol.
Les
nouveaux administrateurs élisent M. Marcel Sarraud à la présidence de la
laiterie. M. Robin, le directeur, s'inquiète de l'avenir de l'entreprise.
1963 : La situation financière de la
laiterie est catastrophique. Elle ne peut plus payer les sociétaires. Au
mois de mai, la laiterie coopérative voisine de Coulon ramasse le lait du
secteur. Les ouvriers vont travailler à Coulon. La laiterie du Bourdet
cesse toute activité et fusionne avec la laiterie coopérative de Coulon.
Le lait de ses sociétaires est ramassé et récolté par cette usine du
Marais située à une quinzaine de kms. Les bâtiments de Le Bourdet sont
alors désaffectés, puis vendus peu après à un particulier, qui va par la
suite les restaurer et les transformer en logements.
1964 : Le 22
Juin, le dernier conseil d'administration, présidé par M. Sarraud avec les
vice-présidents, MM. René Guinot et Henri Denoue, signent l'accord de
fusion avec la laiterie de Coulon.
Les
bâtiments sont vendus à un particulier, qui les transforme en logement.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rédaction et mise en page ED - © letyrosemiophile.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()