|
Historique : Depuis 1893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Celles-sur-Belle est connue dès Le XIIe siècle, par son pèlerinage à la
Vierge Marie, puis par les fréquents séjours que le roi Louis XI, y fit. Le
Roi de France, Louis XI, obsédé par la peur de mourir, vint plusieurs fois
à Celles. Il fit rebâtir l'église abbatiale, augmenta les privilèges de
l'Abbaye et exempta ses habitants de tous impôts, durant sa vie.
Depuis cette époque, la ville est tombée dans l'oubli, mais va se
réveiller ...grace à "l'or blanc" produit par ses vaches.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
       |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vers 1890 : Une première petite laiterie particulière s'installe dans
un moulin à blé "le moulin de la Vée". Elle utilise
des
mécanismes entraînés par une roue de dessus, qui développe une puissance
de cinq chevaux pour une chute de 2,95 mètres.
Mais la laiterie périclite rapidement
puisqu'en 1906, Julien Sabourin
dirige une minoterie dans ce moulin, qui cesse de fonctionner dans les
années 1940. Puis les locaux sont transformés en logement. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
       |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1893 :
Un petit groupe de cultivateurs
ayant la volonté de retirer un meilleur rapport de leurs produits, se
réunit, en cet après-midi du 25 mars. Dans la soirée, la
décision est prise de fonder une laiterie
coopérative à Celles-sur-Belle. 200 agriculteurs font partie de la toute
fraîche société.
La laiterie coopérative s'établit
sur les bords de la Belle, dans un
petit hameau proche du bourg, au lieu-dit "la Mouline". |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1897
: Afin de faciliter la réception de marchandises et expédier plus
rapidement ses produits, la laiterie est transférée sur l'emplacement
qu'elle occupe actuellement, à 300m de la gare de Celles. De plus, un point d'eau alimente abondamment
l'usine. La société grossit, avec 700 inscrits.
1904 : Le constructeur "Douane" installe un système réfrigérant
fonctionnant au CH3 Cl et produisant 60 kilos de glace à l'heure, pour
l'affermissement du lait et
la production de glace.
1905 : M. Moreau, de Vitré, assume la présidence du conseil. Il est
secondé dans sa tache, par A. Proust de "Négressauve" et M. Daniel
Thébault, de "Maison-Celles", les deux vice-présidents.
M.
Alcide Magnein, le directeur-comptable, pense déjà aux nombreux
perfectionnements qu'il faut apporter, notamment sur les appareils.
1906 : Le jeudi 21 juin 1906, un
accident survient dans la salle de malaxage de l'usine. Le contrôleur,
remplaçant le beurrier malade, venait de mettre une courroie sur la
poulie, lorsqu'en
descendant de l'échelle, sur
laquelle il était monté, ses vêtements furent saisis et arrachés, par une
autre poulie, qui heureusement tournait au ralenti. La présence d'esprit
du chauffeur, M. Bernard, fut décisive. Il arrêta immédiatement la
machine, empêchant de plus graves conséquences. Le contrôleur en fut
quitte pour quelques contusions nombreuses mais sans gravité.
Décidément à Celles, les
''miracles" comme au Moyen-Age, lors des pèlerinages dans ses murs, refont
leurs apparitions. |
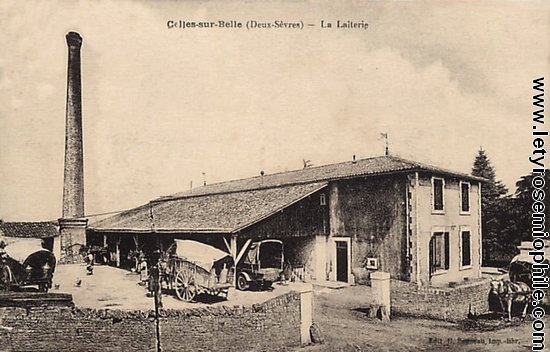 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C'est au tour de M. Moreau, le
président, de se mettre en évidence, bien malgré lui. Au mois d’août de
cette même année, il accomplit un acte de dévouement qui sauve la vie d'un
cultivateur de Vitré, M. Juchaut. Celui-ci était monté sur son cheval,
garni de son harnais et des traits, lorsque le cavalier, en tombant, eut
les jambes prises dans les longes de cuir. L'animal s'emballant, le
malheureux aurait certainement péri, si M. Moreau ne s'était pas jeté à la
tête de la bête, et n'avait réussi, aidé d'un voisin accouru en hâte, à
maîtriser le cheval affolé. L'action courageuse du président n'est pas
près d'être oubliée, par le "miraculé'' agriculteur. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
1909 : 280 autres sociétaires rejoignent leurs camarades. Les 20
laitiers, payés cinq francs par jour, transportent le lait de 3.000 vaches
Parthenaises. La laiterie travaille quotidiennement 10.149 litres, que les
quatre ouvriers convertissent en 530 kg de beurre.
Toujours pour l'année courante, le
contrôleur constate un cas de fraude. Il en fait part au directeur, qui
mène son enquête. Le coupable confondu et convaincu de trafic, se voit
condamné, par le conseil d'administration, à une amende de 1.350 francs.
Son lait contenait 25% d'eau.
Les
nouveautés que souhaitait le directeur arrivent enfin. De nouveaux
appareils sont installés, et en priorité la machine frigorifique, dont les
effets deviennent incontestables.
Pour
l'instant le petit lait retourne aux sociétaires. Mais on songe à
fabriquer de la caséine, pour en tirer un meilleur parti. Les paniers
d'osier, contenant 10 kg de beurre, partent par chemins de fer, dans les
wagons réfrigérés et spécialement conçus par l'Association des Laiteries
Coopératives, en direction de la capitale. Les frais de transport, se
chiffrent à 40 francs, toutes taxes comprises, par 100kg de beurre
convoyés. Arrivé à destination, le produit est vendu par les mandataires,
prenant au passage et légalement une commission de 3% environ.
1913 : La collecte se monte à
4.156.882 litres pour cette année là. La production beurrière atteint
216.605 kg, à la satisfaction du président Moreau.
1914/18 : La guerre provoque une baisse de la quantité laitière, comme le
consigne Alcide Magnein, le dévoué directeur. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1923 : La laiterie dépasse les 4 millions de litres collectés. Elle
retrouve son niveau, d'avant le conflit mondial.
Depuis trois ans, M. Albert Poujet remplace M. Magnein, à la direction. M.
Jacques Moreau, le sympathique président a lui aussi, cédé sa place, en
1920, à M. Braconnier Raymond, de St-Romans. Ce dernier reste jusqu'en
1922. Son successeur est M. Auguste Fouchier, du hameau de "Mortefond de
Verrines".
1940 : M. Octave Proust devient le
nouveau directeur.
Jusqu'en 1947, la coopérative
poursuit son ascension. Elle décide la construction d'une fromagerie
pour la fabrication et l'affinage de fromage.
1948 :
Pour se diversifier, du fromage est donc fabriqué à Celles-sur-Belle, plus
exactement des fromages frais de
vache pour commencer.
Pour compléter la production, il est décidé de
fabriquer des fromages de chèvres. Les
laitiers entreprennent donc la première livraison en lait de chèvre. Et la
fabrication de ces fromages de chèvre est une réussite.
1949 : Le
nombre des adhérents est passé de 250 en 1892, à plus d'un millier. Cet
accroissement a entraîné une production laitière intense, variant
annuellement de 830.000 litres à ses débuts, à plus de 6.000.000 de
litres.
1952 : L'arrivage du lait augmente considérablement. Le total a presque
doublé depuis trente ans. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
1954 : Pour assurer une qualité
parfaite du beurre et un rendement supérieur qui permettent une forte
rentabilité du lait, il a été procédé à une sélection méthodique et
minutieuse de la race de vache Parthenaise.
Quant à la production de
lait de chèvre, elle atteint 4.500 litres par jour, permettant une forte
production de fromages de chèvre très appréciés dans le Poitou. Par son
installation moderne, la laiterie de Celles peut être classée parmi les
meilleures de la région.
M. Moreau Marcel, Officier de la Légion
d'Honneur, Officier du Mérite Agricole, Officier d'Académie, Croix de
Guerre avec Palme, assure les fonctions de Président de la Laiterie. Il
est secondé par l’infatigable M. Boissonnet, directeur. |
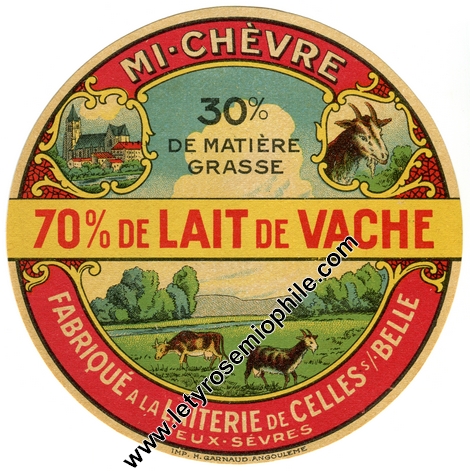 |
|
|
|
|
|

1954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |

1954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Camembert "Vallée de la Belle"
représentant l'abnbaye royale de
Celles-sur-Belle. |
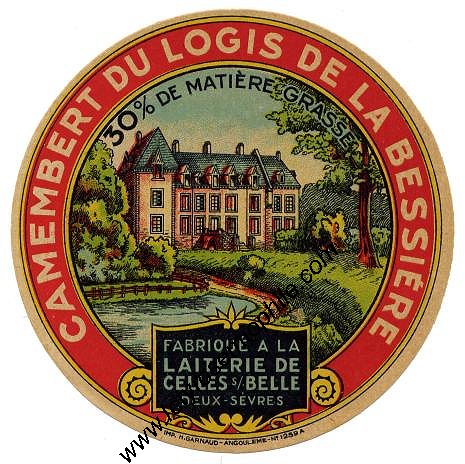
Camembert du logis de la Bessière
représentant le château de La Bessière
à Beaussais-Vitré. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1954 |
1958 :
Le bâtiment de laiterie est démoli et reconstruit. De 1958 à
1983, de la poudre de lait est élaborée selon le procédé Spray, pour lequel
est édifié un atelier. Depuis 1983, cette fabrication est faite dans
l'unité de production de Champdeniers (79).
1960 : M. Jean Boissonnet dirige l'entreprise avec brio depuis 1950. Les
sociétaires, reconnaissent sa grande compétence, avec à leur tête depuis
1941, Marcel Moreau. |
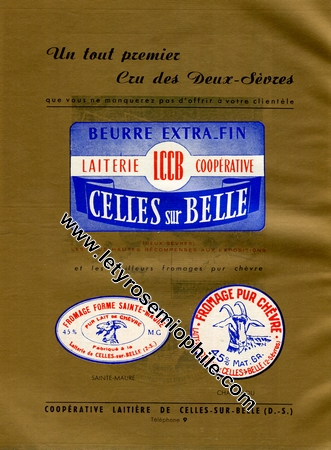 |
|
|
|
|
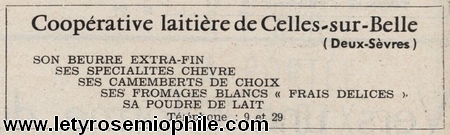
1961 |
|
|
|
|
 |
1964 : Le 31 septembre, le dernier laitier à cheval
du pays Mellois M. Constant Baudouin, de ''la Groie", cesse ses tournées.
En 22 ans de travail il a parcourut quelques 120.000 kilomètres. Figure
lécendaire du paysage Cellois, il faudra s'habituer à ne plus voir la
charrette et la jument de Constant.
1973 :
Une nouvelle fromagerie est édifiée, qui est prolongée en l'an 2000. |
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
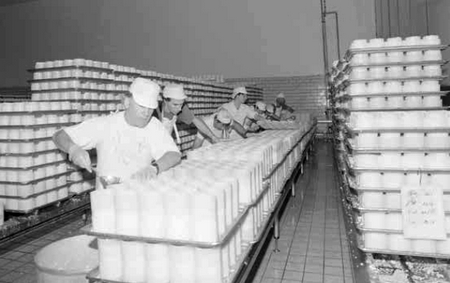
Moulage à la louche des fromages en 1973. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
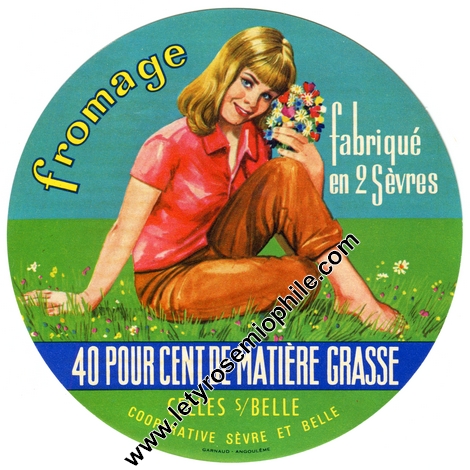 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 : Cette année marque un tournant important dans la croissance de la
coopérative. La zone de ramassage s'agrandit énormément.
Déjà, elle débuta
dès 1957 en récupérant les sociétaires de Vouillé, puis en 1968, ceux de
Chizé. Et présentement vient le tour des adhérents de la Crèche, de
Saivres-Castarie et St-Maxire. Les trois dernières fusions vont aboutir à
la création de "Sèvre & Belle, au mois de juin.
1980 : Le mandat de M. Moreau prend fin, après 30 ans de présidence. Son
successeur est M. Maurice Laurant, de "Villeneuve de Chavagné".
1981 : M. Boissonnet passe les
rênes à M. Bernard Magneron. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
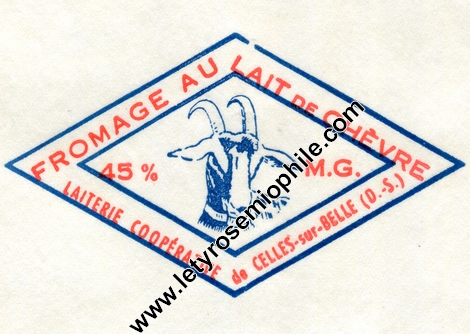 |
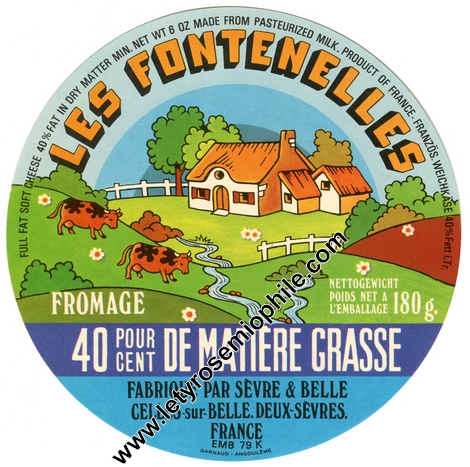 |
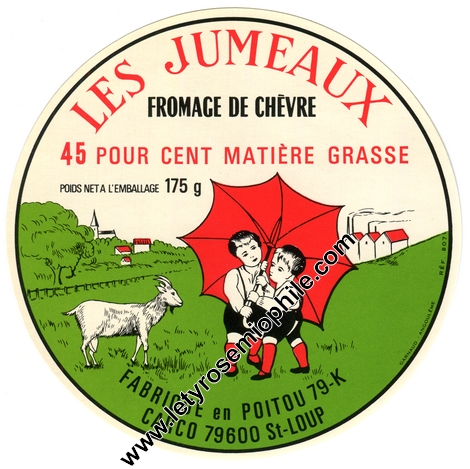 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
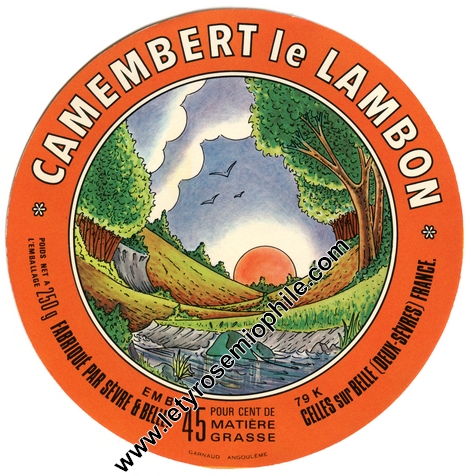 |
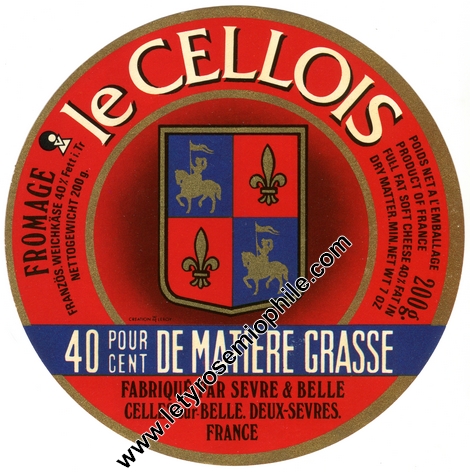 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
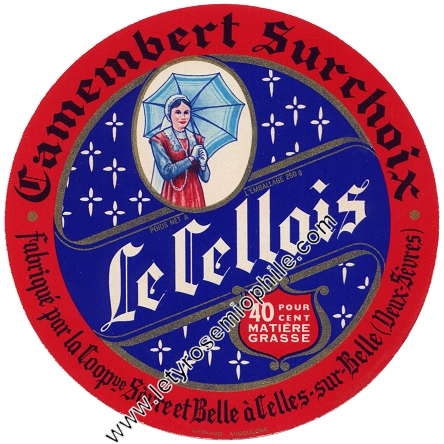 |
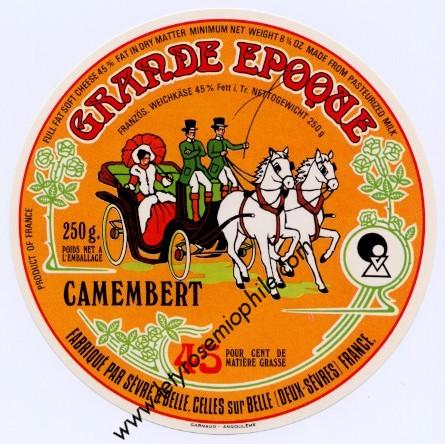 |
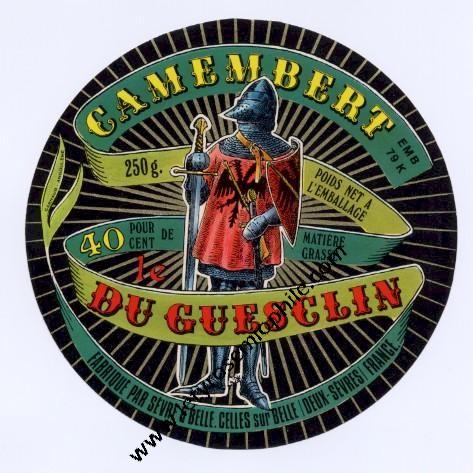 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985 :
La cheminée en brique est démolie.
1986 : Cette année témoigne une nouvelle initiative du nouveau directeur
et du conseil d'administration. Dans le cadre de l'Union Laitière de la
Sèvre (l'ULS), les laiteries Sèvre & Belle et Echiré signent un accord,
prévoyant des échanges de lait, Celles donnera du produit de ses vaches et
Echiré de ses chèvres.
1988 : Le 1er janvier, M. Bernard Morisset devient le président de la
coopérative. Elle compte dorénavant 125 salariés, Elle transforme 6,3
millions de litres de lait et exporte en Grande-Bretagne, aux USA, au
Canada, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Belgique et en Allemagne.
Tout travail mérite récompense.
Cette formule s'applique parfaitement à Sèvre et Belle. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
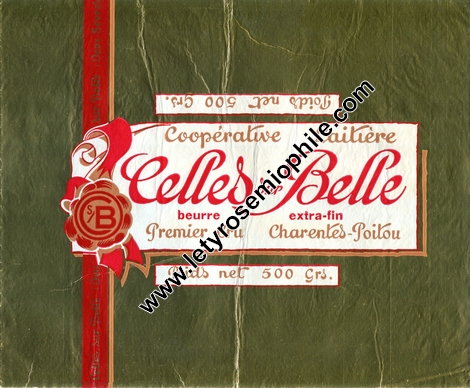 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
1989 : En juin, elle reçoit "Les lauriers d'Or de la qualité" décernés par
le Comité France Promotion, pour quatre excellents fromages de chèvre.
Ceux-ci, "le Chevrot", "le Chèvrefeuille", "le Chèvrepaille" et "le
Caprichaud" obtiennent la suprême et belle récompense.
Le but idéal recherché par les dirigeants, est la qualité
à tous les échelons de la production et de la transformation. Elle devient
une obsession et le projet principal de l'entreprise.
Le lait de vache
collecté sert essentiellement à la fabrication de beurre, le lait de chèvre
à celle de fromages frais ou affinés. |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 : Cette laiterie fabrique de
nombreuses variantes de fromages de chèvres, les moulés à la louche au
lait cru, les chèvres-boîte typiques de la région et les délicieux
fromages à tartiner. Elle propose également des fromages au lait de
mélange (avec du lait de vache), du beurre grand cru AOC, médaillé d'Or au
concours général agricole 2012, de la crème crue et du beurre Baratte d'Or
au lait cru, dernier-né de la gamme, spécialement élaboré pour permettre
aux consommateurs de retrouver les saveurs d'autrefois. Savoir-faire et
tradition restent leur point fort, le secret bien gardé de leur qualité.
La société s'est agrandie en 2013 et devient toujours un peu plus
l'étendard du savoir faire de la région en matière de produits laitiers.
2023 : Dans les Deux-Sèvres, la Coopérative laitière de la Sèvre qui
fabrique les fromages Sèvre et Belle et le beurre d'Echiré annonce
s'adosser à deux coopératives régionales : Terra Lacta, première
coopérative laitière de Nouvelle-Aquitaine basée à Surgères et Océalia
basée à Cognac. "Les coopératives du territoire Cap Faye, Sèvre & Belle
Céréales Appro et Pamplie participeront également à ce projet", précise un
communiqué ce mardi 5 décembre. "L’adossement d’un partenaire a été guidé
par la volonté commune d’assurer la pérennité de l’exploitation, la
préservation des emplois, la valorisation de la rémunération des
producteurs et la conservation des sites", poursuit le communiqué. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rédaction et mise en page ED - © letyrosemiophile.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()