|
Historique : 1897 - 1982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1897 :
Trois riches propriétaires, M. Vivon (1955-1932) de St-Varent et MM. Morin et Deboeuf
de Chiché, fondent la laiterie de Laubreçais, près de Clessé, sur un
terrain au lieu dit "l'Armentière". Le
choix du site fut déterminé par la proximité de sources.
Les laitiers ramassent le lait
entier pour la fabrication du beurre et des fromages. M. Deboeuf gère la
laiterie.
1900 : Le constructeur "Delion et Lepeu." installe un système réfrigérant
fonctionnant au SO2 d'une puissance de 4.000 frigories.
1902 : La laiterie reçoit une médaille d'argent pour son
beurre, au Concours Général Agricole de Paris.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Pendant deux décades,
l'établissement poursuit son petit bonhomme de chemin, malgré
l'implantation de nouvelles laiteries dans le secteur.
1921 : Coup dur pour Laubreçais. Le 24 Octobre,
l'image de marque de l'entreprise est compromise. M.Paul Octave Deboeuf,
le directeur, se voit condamné par le tribunal de Parthenay, pour
tromperie sur la qualité des camemberts fabriqués dans la fromagerie qu'il
dirige.
Les magistrats lui infligent une amende de 500 francs et 15 jours
de prison avec sursis.
Les juges sont particulièrement sévères avec ce
genre d'infraction. Les marchandes de lait (qui coupent fréquemment leur
lait avec de l'eau), les laiteries, les boulangers, les charcutiers et les
bouchers reçoivent inopinément la visite de fonctionnaires qui prélèvent
des échantillons. Malheur à ceux qui trichent.
|

1920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Réau reprend l'entreprise en main. Son sens des affaires, tout
différent de celui de ses associés, amène ces derniers à vendre leurs
parts. M. Fouard, négociant à St-Varent, en acquiert une partie. M.
Caillaud remplace M. Deboeuf à la direction.
Avec ces deux nouveaux propriétaires,
Laubreçais se trouve dès lors apparenté à la laiterie de Riblaire, de part
leurs actionnaires communs.
1923 :
M. Réau, cherchant une personne jeune et dynamique pour diriger l'usine,
fait appel à M. Clément Auger. Son père est le directeur de la laiterie de
La Viette.
Les trois ouvriers de la beurrerie reçoivent
quotidiennement 4.000 litres de lait que leur apportent les 10 laitiers
indépendants.
La concurrence est bien implantée dans la
région. Les produits se vendent mal et les producteurs sont mécontents.
Depuis cette fâcheuse affaire il y a deux ans, les gens sont méfiants. Il
faut à tout prix imposer un produit de qualité et retrouver la confiance
des consommateurs. M. Auger s'y emploie.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
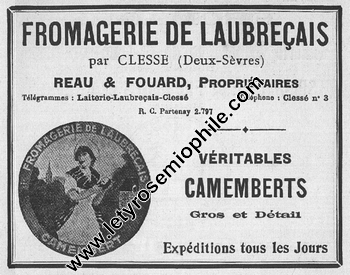
Encart publicitaire de 1929 |
1926 : Après bien des efforts et des sacrifices
financiers de la part des propriétaires ainsi que de dures journées de
labeur du directeur, la situation se rétablit petit à petit.
Il a fallu changer le mode de ramassage, car les producteurs préfèrent
garder le petit lait pour élever leurs porcs. Ceci a nécessité
l'installation d'une écrémeuse dans chaque camionnette. Seule la crème est
ainsi ramenée à l'usine pour la fabrication du beurre. Ce changement a
bien sûr, amené des transformations à l'intérieur des bâtiments. La
production s'écoule en province : à Lille, Roubaix, Tourcoing, Lyon, Nice,
Marseille, Béziers, Clermont-Ferrand...
Guerre
1939/45 : Elle entraîne de nombreux problèmes comme la mobilisation, le
recrutement de nouveaux laitiers et le retour au ramassage hippomobile
avec toutes les contraintes d'une cavalerie. C'est vraiment l'époque
pénible. La fabrication change aussi. On garde quelques tournées de
ramassage de lait entier pour la production de fromages maigres.
Ils sont expédiés dans certains grands centres comme Paris et Bordeaux.
Le beurre est écoulé pratiquement sur place
avec l'instauration des tickets dans les épiceries crémières de la région
du Bocage, de la Gâtine et Niort avec sa livraison du jeudi. Là
apparaissent les véhicules gazogènes, surnommés "les gazos". |
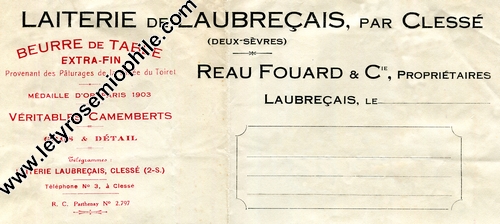
Facture de 1929 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L'après guerre voit à nouveau un retour à la
collecte de la crème et la commercialisation en province mais aussi aux
halles centrales de Paris. Il faut "jouer serré" car la concurrence est
forte et seule la qualité peut s'imposer.
"Laubreçais" a la chance de faire partie des grandes
marques de beurre des Deux-Sèvres. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1955 :
Le monde est en pleine évolution. De nouveaux produits, telle la poudre de
lait, font une apparition remarquée sur le marché national.
1961 : Au faîte de son apogée, la laiterie
entre dans l'Union des Laiteries Industrielles des Deux-Sèvres, avec
Secondigny et Riblaire. Pour faire face aux laiteries coopératives qui
commencent à fusionner et deviennent de redoutables rivales, l'Union
installe une usine de poudre de lait à Riblaire, et qui sera alimentée par
les trois laiteries.
1962 :
Ne faisant plus la fabrication des fromages, les laitiers commencent à
recueillir le lait du cheptel caprin du secteur qui est ensuite acheminé à
la fromagerie de Riblaire. Les premiers fourgons remplacent les
camionnettes. Le rayon d'action s'est agrandi. Les propriétaires ont
acheté la laiterie Barribaud de Parthenay depuis cinq ans et le volume de
lait ramassé se chiffre maintenant à 100.000 litres par jour plus le lait
de chèvre
1963 : Un drame endeuille la
laiterie. Un froid intense règne depuis quelques jours sur la Gâtine. Les
routes sont verglacées. Le laitier M. Germain Fourré se tue au volant de
sa fourgonnette. A l'entrée du village de St-Germain-de-Longue-Chaume, son
camion est entré en collision avec un fourgon. Le véhicule n'ayant pu
s’arrêter sur le sol gelé, le choc fut violent. M. Fourré était âgé de 58
ans. Il ramassait le lait pour la laiterie depuis 1957 et auparavant pour
la laiterie Barribaud de Parthenay. Apprécié et aimé de tout ses collègues
il laisse le souvenir d'un travailleur zélé.
1965 :
La laiterie est à son maximun. Elle emploie 25 ouvriers et 24 laitiers.
Tout va pour le mieux.
1968 :
Vers la fin de l'année un nouveau malheur s'abat sur l'ensemble des trois
laiteries du groupe. Le principal actionnaire M. Réau décède. Ses neveux
lui succèdent.
1969 :
Le directeur M. Clément Auger prend une retraite méritée. Son gendre M.
Gilbert Roy prend la succession. |
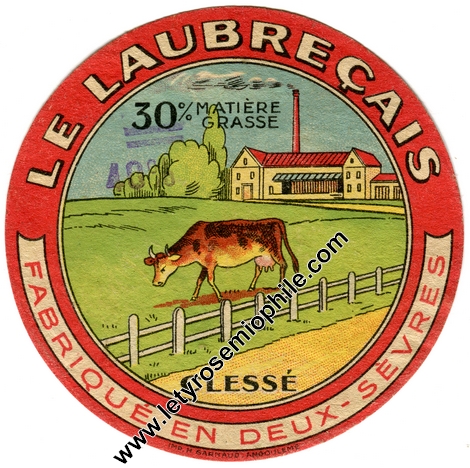 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 :
Les actionnaires vendent leurs parts à ATLALAIT, un important groupe de
Nantes. Le regroupement de l'atelier de fabrication de beurre s’effectue
sur la laiterie de Riblaire, avec des mutations et des départs. La
laiterie devient un centre de collecte. Elle récupère le lait de ses
laitiers ainsi que celui de la laiterie de Secondigny qui a subi le même
sort.
1978 : M. Roy est muté à
Riblaire comme directeur commercial. M. Billerot le directeur de
Secondigny le remplace.
1981 :
Le groupe ATLALAIT vend l'ensemble de ses usines au puissant groupe
Besnier de Laval. Il n'y a plus beaucoup d'espoir de survie pour la
laiterie.
1982 : Au début de l'année, elle
ferme définitivement. Elle était la dernière laiterie industrielle de la
Gâtine.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rédaction et mise en page ED - © letyrosemiophile.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()