|
Historique : 1890 - 1970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1890 : Le 1er Mai, plus de 200 paysans
convergent vers la Patrie de l'explorateur M. René Caillé, décédé il y a
deux ans, et qui fut le premier européen à pénétrer à Tombouctou (Mali) en
1828. L'enfant célèbre de Mauzé aurait certainement apprécié l'initiative
prise ce jour par une poignée d'agriculteurs conquis par la volonté d'un
homme, M. Festy du "Moulin à Drap", qui refuse de voir mourir son village.
La commune a vu
tout son vignoble anéanti par le phylloxéra, il y a cinq ans. La vigne
était sa seule richesse. Et depuis, la population semble se résigner à
cette fatalité. Désormais, on se tourne vers l'agriculture, l'élevage et
la production de lait.
Au début de cette année 1890, M. Festy et
quelques propriétaires, se rendent dans la petite commune charentaise de
Chaillé, distante d'une dizaine de kilomètres et où M. Eugène Biraud a
installé la première laiterie coopérative de la Charente inférieure. Les
fermiers mauzéens en reviennent enthousiasmés et convaincus qu'ils doivent
réaliser la même chose chez eux pour sortir de la misère leurs collègues.
Reste à les persuader de tenter l'aventure. Après bien des efforts, M.
Festy parvient à cette réunion d'aujourd'hui. Dans la soirée, la laiterie
coopérative de Mauzé est née. La présidence revient à son créateur M.
Festy.
Les murs de la future
beurrerie vont s'élèver à 400 mètres du bourg, près de la gare de Mauzé. Les
bâtiments, d'une longueur de 22 mètres, comprendront 9 pièces, dont 6
seront affectées au service de l'usine, les 3 autres, au logement d'un
employé.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Le 14 Juin 1890, le directeur-comptable, M. Tardy, le beurrier M. Gustave
Chémereau et deux ouvriers, reçoivent les premiers litres de lait,
ramassés chez les 240 sociétaires.
L'écrémage s'opère de très bonne heure, le matin. A cette époque, le rayon
d'action de la laiterie n'est pas très étendu, six kilomètres seulement.
1898 : L'entreprise collecte pour l'année
1.417.900 litres qui produisent 66.214 kilos de beurre. Celui-ci se vend
2,65 francs aux Halles de Paris. La
coopérative compte maintenant 280 sociétaires, possédant un troupeau de
935 vaches de races très diverses.
1905 : "Un drame évité de justesse".
Le
samedi 4 Avril, vers 10h du matin, le laitier M. Cerceau, habitant le
village de "la Revêtison", s'en retournait, après avoir porté son lait à
la laiterie. Soudain, en arrivant dans la rue "Contre-Amiral Savarit", son
cheval prend peur et part au galop, en entraînant avec lui la lourde
charrette. M. Cerceau, jeté à terre, est inerte, sa tête ayant percuté le
sol. Pendant ce temps, l'animal continue sa folle chevauchée, terrorisé
par le bruit des bidons vides qui s'entrechoquent. La pauvre bête, excitée de plus par la
chambrière (pièce mobile qui sert à tenir horizontalement la charrette
quand celle-ci n'est pas attelée) qui lui fouette les jambes, s'engage
dans la Grand'Rue. Profitant d'un légrer ralentissement du
cheval, le teinturier, M. Jules Blay, se jette à l’encolure de l'animal et
parvient à maîtriser ce dernier. Par miracle, personne n'a été renversé,
ni blessé. Seul le laitier, M. Cerceau en est quitte pour une grosse bosse
et quelques jours de repos.
Le
beurrier, M. Chémereau fête ses 15 ans de travail assidu à la laiterie.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1906 : Le Dimanche 14
Janvier, se déroulent les élections du Conseil d’Administration. M.
Picaud, l'ancien président depuis 12 ans, ne se représente pas. Le nouveau
bureau le nomme président honoraire, sous les
applaudissements des
sociétaires présents. Les administrateurs élisent M. Marie-Jules Bussac à
la présidence, et M. Albert Brouillac comme vice-président.
1907 : Avec l'arrivée de M. Clovis
Moinier, ce sont maintenant 4 employés, toujours sous la conduite de M.
Tardy, qui traitent les 1,7 millions de litres que leur rapportent les
laitiers. Parmi ceux-ci, on peut voir le solide M. Cerceau, bien remis de
sa mésaventure, et deux nouveaux, MM. Jean Delavaud et Louis Morisset.
On apprend avec joie, que le
président, M. Bussac, vient d'être nommé Officier du Mérite Agricole.
1909 : La laiterie se refait
une jeunesse, en changeant son vieux matériel. Deux écrémeuses, une "Alfa-Laval" et
surtout une "Astra-Laval", considérée comme la plus performante de
l’époque, sont installées. De plus, l'entreprise s'équipe d'appareils pour
la pasteurisation, en cas d'épidémie. Après
19 ans d'excellent travail à la direction de l'usine, M. Tardy peut enfin
profiter d'un repos bien mérité. M. Félix Clerc vient le remplacer.
Cette année là, la laiterie remporte la médaille
de bronze au concours général agricole de Paris pour la qualité de ses
beurres. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
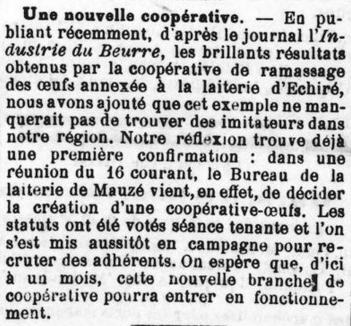
23 février 1910, L'Echo Rochelais |
1910 : Les 2 millions de litres de
lait seront certainement atteints à la fin de l'année. C'est du moins
l'objectif que se fixe le président, M. Bussac, en ouvrant la séance de
l'Assemblée Générale de ce mois de janvier. Les 350 sociétaires, possédant
1030 laitières, espèrent assouvir les souhaits du dirigeant. lls ont déjà
réalisé un grand effort dans la sélection de la race bovine. Depuis deux
ou trois ans, l'espèce prédominante est la "parthenaise".
Une partie du lait écrémé sera vendue
dorénavant à un industriel, l’autre quantité de petit lait est achetée par
le fermier qui exploite la porcherie.
L'installation d'une porcherie,
annexée à la laiterie, a été créée en même temps que cette dernière. Le
fermier signe un bail de 10 ans, renouvelable en fin de contrat.
L'exploitant engraisse 250 porcs. Leurs aliments se
composent de lait, de farine d'orge, de grains bouillis et de
glands ramassés à l'automne dans la forêt de Chizé. Les animaux sont achetés à l'âge de 3 mois
et gardés dans l'établissement pendant 4 mois environ. Le petit lait est vendu au fermier au prix
de 1,05 fr l'hectolitre. Depuis
l'épidémie de pneumo-entérite (maladie souvent mortelle qui attaque les
poumons et les intestins chez le porc), qui a fait des centaines de
victimes en 1895, aucune maladie contagieuse n'a été constatée sur les
animaux. |
 |
|
|
|
|
|
|
Le 29 janvier, M.
Babaud-Bosssuet est nommé président de la laiterie coopérative. Cette année 1910 voit aussi l'édification
d'un atelier de fabrication de caséine.
1912 : Le 16
Février, suivant l'exemple de la laiterie d'Echiré, M. Festy crée la
coopérative de ramassage d’œufs.
1913 : En ce mois de février, la laiterie remporte la médaille d'argent au
concours général agricole de Paris pour ses beurres.
1914 : Au mois de février, la
laiterie gagne une
médaille d'or au concours général agricole de Paris, pour l'excellence de
son beurre.
La grande tragédie mondiale
éclate. La mobilisation éclaicit les rangs des laitiers et des ouvriers.
On essaie, tant bien que mal, de trouver des remplaçants. Parmi ceux-ci,
M. Jules Larelle effectue le ramassage du lait, avec sa mule. A l'appel des sociétaires, le fondateur de
la laiterie, M. Festy, revient à la présidence. |
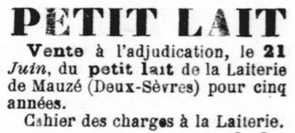
juin 1914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
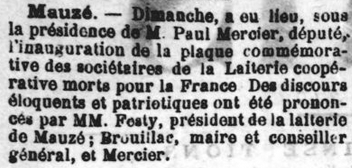
26 novembre 1921, L'Echo Rochelais |
1924 : Deux employés partant en retraite sont remplacés par M. Marcel
Barbot, comme beurrier et M. Marcel Mesureau, comme laitier.
M. Festy préside pour la dernière fois le
conseil d'administration. Il pense qu'il est temps de laisser la place à
plus jeune que lui. M. Richard
hérite de celle-ci.
1929 :
Après la première Guerre, la porcherie s'agrandit et se modernise. |
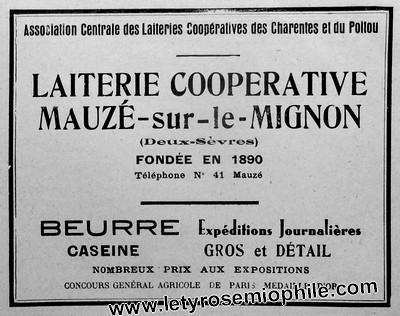
1934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1936 : "Décès d’un grand président"
: M. Festy vient de s'éteindre.
Avec lui, disparaît le nom d'une des plus anciennes familles de Mauzé,
dont les membres, au cours du siècle dernier, ont eu une large part à la
vie administrative communale. Son
père fut Maire de Mauzé et décéda en 1870. Lors de la disparition du vignoble mauzéen,
Théodore Festy fut l'un des premiers à chercher le remède à ce fléau. Et
dès qu'Eugène Biraud de Chaillé eut mis son idée en pratique, M. Festy,
subjugué comme d'autres propriétaires, fondait la laiterie de Mauzé, en
1890. Elu président pendant quatre
ans, il se retira alors et fut nommé président d'honneur. En 1914, un nouvel appel étant adressé à sa
compétence et son dévouement, il reprit la tête du conseil et l'exerça
jusqu'en 1924. Il redevient Président d'Honneur. De plus en 1912, toujours fidèle au
principe coopératif, il créa la coopérative d'oeufs, dont il fut le
président jusqu'à sa mort. Il était
Officier du Mérite Agricole. Constamment disponible et à l'écoute des
sociétaires, il restera comme l'un des hommes qui aura contribué à
l'amélioration des conditions de vie des paysans mauzéens. Une foule
énorme et de nombreuses personnalités l'accompagnent à sa dernière
demeure.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1939-45 : Comme les autres
laiteries, Mauzé tournera au ralenti pendant la seconde guerre mondiale.
Son président est M. Aristide Jean, le propriétaire des Etablissements
Monnet S.A., spécialisés dans la fabrication de la caséine, dont une usine
est installée à Mauzé et l'autre à Chambon, en Charente-inférieure.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
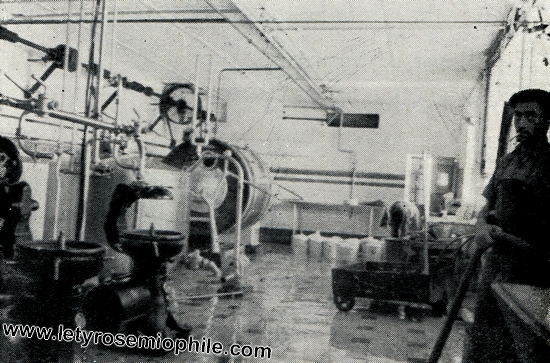 |
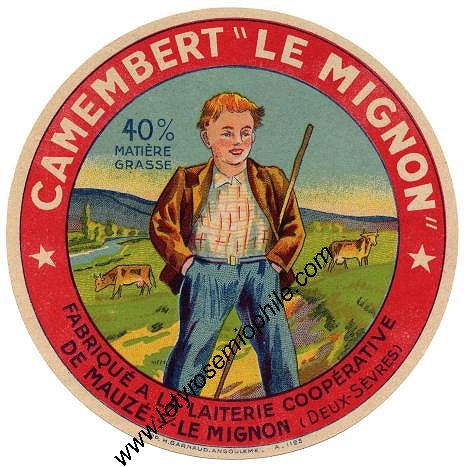 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
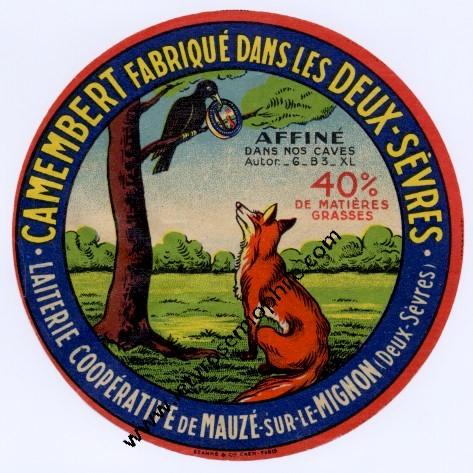 |

1947 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
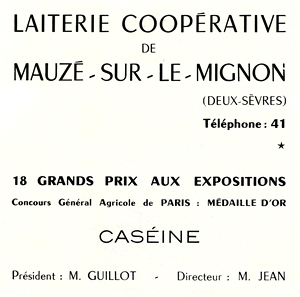
1954
|
1950 : Sous la conduite du
directeur M. Louis Jean, la laiterie reprend son rythme normal. Le conseil
d'administration a élu à la présidence M. Pierre Guillot.
1952 : La collecte annuelle s'élève à 2,7
millions de litres. L'entreprise fabrique depuis quelques temps de la
poudre de lait selon le procédé
Hatmacker.
1956 : Les
laitiers ramènent 145.000 litres de lait de plus, par rapport à l'année
1952. De nos jours, ces 1,8 millions de litres ne représentent qu'une
faible quantité en comparaison de celles des autres coopératives. Coulon
ramasse le double, Celles-sur-Belle le triple, La Mothe St-Héray quatre
fois plus.
1958 : M. Pierre Guillot, président de
la laiterie, et M. Monnier, adjoint au maire d'Usseau, reçoivent le 23
septembre, le
mérite agricole au comice de Mauzé-sur-le-Mignon. |

Pierre Guillot et M. Monnier en 1958.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1965 : c'est la
folle époque où le monde laitier bouge. Pour pouvoir répondre aux
nouvelles données économiques du marché, les laiteries fusionnent entre
elles, afin de constituer des groupes, de moyenne importance, capables de
lutter contre la furieuse concurrence. La laiterie de Mauzé comme d'autres,
suscite la convoitise, mais malgré les difficultés qui commencent à
poindre à l'horizon, elle garde son autonomie.
1970 : Après une résistance de cinq ans, le 1er Janvier, toujours sous la
présidence de M. Pierre Guillot, la laiterie fusionne avec la coopérative
laitière de Surgères. Le directeur
M. Jean part à la laiterie de Bois-Hardy, en Charente-Maritime. 80 ans après avoir été ouvertes, les portes
de la laiterie se referment pour toujours.
Les bâtiments sont rachetés par des
particuliers. Plusieurs bâtiments sont démolis,
dont le quai de réception du lait, la chaufferie, le transformateur, deux
des trois porcheries et la cheminée d'usine.
1994 - 2024 : La laiterie à été gardée en bon
état par ses propriétaires. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rédaction et mise en page ED - © letyrosemiophile.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()