Historique : 1891 -
1913 (première laiterie)
1913 - 1953 (deuxième laiterie) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1891
: Le 1er juillet, au cœur de la Venise Verte, dans la paisible commune
d'Arçais, a lieu une réunion importante. lci aussi la "réussite
charentaise" fait des émules. C'est avec enthousiasme et un espoir en des
jours meilleurs, que l'on fonde, ce jour, la laiterie coopérative
d'Arçais. Cette laiterie-beurrerie coopérative est une des plus anciennes
de la région.
Le lieu choisi pour la construction
de l'entreprise se situe à 600 mètres du centre de La commune, au lieu-dit
les Massacrées, route du Vanneau, sur une parcelle achetée par la toute
nouvelle société coopérative à la famille Ducrocq (actuellement n° 30 ;
parcelles 891 et 892 du plan cadastral de 1829). La laiterie se situe à 2km de
la gare.
Les bâtiments sont constitués de
cinq pièces : La salle de la machine à vapeur, l'atelier d'écrémage et de
fabrication, le bureau, une chambre pour le porcher et le local pour le
dépôt de la paille. Sur tout l'ensemble s'étend un vaste grenier. Sous la
salle d'écrémage, une cave fraîche abrite les mottes de beurre.
Le matériel se compose d'une machine à vapeur de 5ch, d'un bassin à lait
d'un réchauffeur système "Hignette", de deux écrémeuses'"Nielsen" ayant
chacune un débit de 400 litres à l'heure, d'une baratte "Chapelier'', d'un
malaxeur, d'une table en bois et une en marbre, des moules à beurre et
d'autres petits accessoires.
1892
: Sous les ordres de M. Louis Bonneau, le directeur-comptable, deux
ouvriers s'affairent à la confection du beurre. Trois ramasseurs apportent
le lait dans des charrettes. Leurs tournées durent un peu plus de deux
heures.
Un gros problème, non prévu, se
pose avec les grandes chaleurs de cete été. L'eau n'abonde pas et le puits
se trouve à sec. Il faut creuser pour puiser dans une autre nappe
souterraine.
La porcherie, située à 50m de la
laiterie, abrite environ 80 porcs.
1893
: La coopérative compte 197 sociétaires qui possèdent 470 vaches laitières. La
race majoritaire est la "Maraîchine". En été, elles sont conduites au
pâturage. On leur donne, en outre, des fourrages verts, de l'herbe coupée
dans les marais et un peu de foin. En hiver, la nourriture se compose de
foin, de racines et de son. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
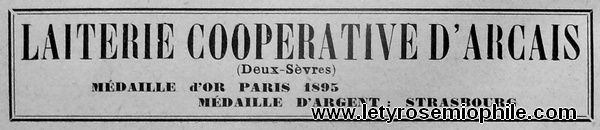 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1895
: Les trois laitiers ont transporté une quantité annuelle de 970.320
litres qui ont permis de produire 43.540 kilos de beurre, vendu à Paris de
1,70 fr. à 2,00 fr. le kilo. La laiterie remporte sa première médaille
d'argent au concours de Strasbourg.
Le
18 Avril, la laiterie cède la porcherie, peu rentable, à un fermier.
1900 : Ce sont maintenant 210
sociétaires, possédant 630 vaches, qui donnent le lait à la beurrerie.
Dans celle-ci, l'écrémage s'effectue chaque jour de 8h à midi. Le
barattage commence dès 5h du matin et jusqu'à 9h.
La
porcherie ferme définitivement.
1901 : La laiterie est agrandie.
1905
: Le Président, M. Paris, incite les laitiers à redoubler de vigilance.
Certains sociétaires trafiquent certainement leur lait. Depuis le mois de
décembre de cette année, le beurre est de mauvaise qualité. Cela ne peut
durer longtemps, il faut découvrir les tricheurs. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1906
: Enfin, à la fin du mois de janvier, un des coupables, moins méfiant que
les autres, est soupçonné. Il s'agit maintenant de le confondre.
Le 5 février, le garde-champêtre et
le vérificateur de lait, se rendent chez le paysan et avec la complicité
du laitier, qui a pris soin de verser le lait du fraudeur dans un bidon
vide, ils prélèvent un échantillon. Pour bien établir la preuve de
tricherie, les deux hommes réclament au paysan un peu de lait tiré au pis
de la vache. Le sociétaire promet de les attendre le soir et le lendemain
matin, pour traire sa bête devant eux. Il ne tint jamais sa promesse.
Devant ce fait de mauvaise foi,
seul le premier prélèvement est envoyé à l'analyse. Le laboratoire de
Surgères constate une addition d'eau de 15% contenue dans le lait.
Le 11 février convoqué devant le
conseil d'administration, le fraudeur avoue sa culpabilité. Son exclusion
est prononcée à l'unanimité des 14 membres présents. De plus ces derniers
lui infligent une amende de 640 francs.
Le
nouveau président M. Achille Manteau constate que l'exemple à servi de
leçon, car le lait redevient de bonne qualité.
Le
28 novembre, décidément le brave président rencontre beaucoup de problèmes
dans sa laiterie. Il convoque, ce jour, le conseil d'administration, pour
débattre sur une affaire qu'il juge importante.
Après avoir délibéré, les membres du bureau votent à une forte majorité,
une décision surprenante et diversement appréciée par le personnel.
"Afin d'encourager le personnel à apporter tous ses efforts à la bonne
exécution de son service, aussi bien en ce qui concerne les soins du
matériel et des matières dont il a la manipulation, que dans ses rapports
avec les sociétaires, tout employé, dont le service aura été reconnu bien
fait pendant l'année écoulée, sera appelé à garder son emploi l'année
suivante en traitant de gré à gré avec le représentant de la société. Le
conseil espère arriver par cette mesure, à une prompte amélioration dans
chaque service et à faire disparaître, dans un avenir prochain, les
dissentiments qui opposent les ouvriers aux sociétaires."
Cette résolution a de quoi étonner. Elle est unique dans les annales de la
jeune industrie laitière. Espérons qu'il n'en résultera pas de trop grands
excès de délation. Il est un peu trop facile à plusieurs sociétaires de
s'entendre, pour dénoncer un laitier ou un employé, afin de prendre sa
place.
1907 : M. Paris redevient
président. Les vice-présidents sont MM. Achille Manteau et Eugène Tardy. A
la trésorerie, on trouve M. Eugène Jourdain et au secrétariat, M. Pierre
Texier.
L'épidémie de fièvre aphteuse, qui
sévit depuis un an, cause de nombreuses pertes dans le cheptel bovin de la
laiterie.
1908 : La laiterie traite
1.003.484 litres de lait et produit 48.481 kilos de beurre. Sa production
est toutefois entravée par une qualité médiocre du lait collecté. Le site
où a été implanté la laiterie manque d'eau, le puits dont elle dispose
tarit facilement.
La présidence change souvent
À Arçais. L'heureux élu est l'ancien vice-président, M. Eugène Tardy.
1909 : Le nouveau directeur, M.
Léopold Avrard prend ses fonctions. La valse des présidents continue.
C'est au tour de M. Eugène Rousseau de prendre les commandes de la
coopérative. Les "Eugène" ont la cote à Arçais.
La
société compte 180 adhérents ayant un troupeau de 634 vaches. Le million
de litres collecté dans l'année, a permis de produire presque 50 tonnes de
beurre.
Il faut noter qu'à Arçais, rien
n'est effectué dans la sélection des laitières. Alors que la plupart des
laiteries deux-sèvriennes ont adopté la race Parthenaise, meilleure
laitière. Ici on trouve des vaches Maraîchines et d'autres de divers
croisements. Le rendement moyen en lait se ressent : Il lui faut la crème
de 20,57 litres de lait pour produire un kilo de beurre, alors qu'à la
Crèche, il suffit de 18,58 litres seulement. La laiterie d'Arçais se situe
dans la fin du classement des laiteries du département. Bien sûr, il y a
pire avec notamment Mauzé avec 22,23 litres et surtout la dernière, la
laiterie d'Epannes avec le triste "record" de 23 litres au kilo.
Et pourtant le beurre d'Arçais se
vend bien à Paris, puisqu'il est négocié au prix de 2,80 francs, par les
mandataires.
Avec une meilleure sélection de son
troupeau, la laiterie ferait de plus amples bénéfices.
1911 : La laiterie engage un nouveau beurrier, en la personne de M.
Philippe Leyssène.
1913 : On décide alors de transférer
la laiterie au sud du bourg, au plus près de la gare pour faciliter
l'expédition des produits.
Les anciens bâtiments des Massacrées
sont vendus en 1922 au maçon Auguste Barraud qui y établit une fabrique de
bateaux en ciment et de parpaings en machefer, tenue par le maçon Auguste
Barraud. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
       |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Etablie en 1913 au sud d'Arçais, vers la
route de St-Hilaire, au lieu-dit la Gare,
la nouvelle laiterie coopérative comprend d'abord, selon le cadastre, une fabrique de
beurre et un hangar. |
|
|
|
|
|
|
|
 |
1914
: La laiterie crée plusieurs dépôts de crème pure à Niort. Cette crème se
vend dans de petits pots, en carton paraffiné, d'une contenance de 60 et
125 grammes. La coopérative peut, à la demande, livrer par 1/2 litre voire
même un litre. Ce sont généralement les restaurateurs et les pâtissiers
qui réclament ces dernières quantités.
Ces pots de crème se vendent dans
la grande ville des Deux-Sèvres, chez M. Dahair dépositaire au 42 rue
Sainte-Marthe et dans les épiceries de MM. Persuy et Pillet, à partir du
mois de Juin.
Au mois de
juillet, toujours dans les mêmes dépôts, la coopérative organise un
important service de vente de lait pasteurisé.
1921 : Un nouveau directeur, M.
Henri Chollet, arrive à l'entreprise.
Cette année là, il s'y ajoute
une laiterie.
A partir de 1924, la nouvelle laiterie produit de
la caséine.
En 1925, l'établissement reçoit une médaille de bronze
au Concours général agricole de Paris, catégorie beurre des Deux-Sèvres et
de Vendée.
1924 : Avec le commencement de La
fabrication de la caséine, le directeur embauche M. Narcisse Chaillé, en
tant que chauffeur-caséinier
1930 : M. Paris est toujours à la
présidence. |
|
|
|
|
|
|
|
1937
: S'y ajoute des bureaux.
1938 :
M. Marcel Marchand entre comme directeur.
1942 : M. Jean Girardin est
embauché comme beurrier, en remplacement de M. James Lamberton. Le jeune
homme bénéficie des conseils du vétéran M. Chaillé.
Les deux seuls laitiers qui
collectent pour la laiterie sont MM. Clovis Rousseau et Louis Méteau.
Sous la présidence
de M. Homère Méteyer, la coopérative connaît comme toutes les autres, les
difficultés conséquentes à la guerre.
1945 : Un atelier de fromagerie est
créé. Une fabrication de gruyère débute peu de temps après.
1952 : Le conseil
d'administration élit à sa tête M. Marcel Dubois. L'ère de
l'industrialisation s'amorce, Arçais comme beaucoup de petites laiteries
jadis très fiables, ne peut survivre seule, compte tenu du faible volume
de lait collecté et transformé et des investissements importants que
l'évolution des techniques laitières exige.
1953 : La laiterie qui ne ramasse
plus que 5.000 litres par jour, va vivre ses derniers jours d'activité.
A la majorité des sociétaires,
réunis lors de l'Assemblée Générale, la fusion avec la laiterie du Mazeau
est officialisée.
Peu de temps après, la production s'arrête. |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L'ancienne laiterie devient un simple centre de ramassage du lait
1955 : La laiterie ferme
ses portes définitivement.
Le bâtiment est acheté en 1956 par Alfred Margié époux
Favriou, demeurant à La Rochelle.
Il abrite aujourd'hui une
activité touristique de location de vélos "La bicyclette verte" et un
gite. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rédaction et mise en page ED - © letyrosemiophile.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()