|
Historique : 1896 - 1976
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Pierre Primault en 1906. |
1896 : Le 6 décembre, M. Pierre Primault,
conseiller général du
canton depuis 1896, et fervent partisan des idées nouvelles propagées par les
"Sudistes'', ose un formidable pari en créant, avec un petit groupe
d'agriculteurs, la première laiterie coopérative du Pays Thouarsais. Dans
cette région si conservatrice, l'entreprise parait périlleuse. D'autant
plus qu'à St-Varent il existe déjà depuis trois ans une laiterie privée au
lieu-dit "Riblaire" à une lieue de la commune. L'activité de la laiterie
de St-Varent se voulait
exclusivement beurrière. Elle fut surnommée par ceux de Riblaire
"la laiterie des rouges". En contre-partie Riblaire était surnommée "la
laiterie des bleus".
La coopérative regroupe une centaine d'adhérents.
M. Primault, qui sera
chevalier de la Légion d'Honneur, devient le président et le
directeur de la laiterie.
M. Hullin, qui sera aussi
maire de la commune, succédera à M. Primault à la tête de l'entreprise.
1897 : Bâtie à 600 mètres de la gare
par l'architecte Paul Mongeaud, la construction située à flanc de
coteau, se divise en trois salles qui abritent les appareils
indispensables à la production beurrière. Juste à côté se trouve une cave
en excavation. Au-dessus des pièces, on aménage les logements des
employés. Enfin un hangar destiné à la réception du lait et une écurie
complètent l'ensemble. Le matériel comprend deux moteurs d'une puissance
de 30ch chacun, six écrémeuses Laval, deux barattes et un malaxeur.
Deux puits d'un débit abondant alimentent
la laiterie.
4 ouvriers et 14 ramasseurs sont recrutés.
En comparaison, en 1970, 65 employés composent l'ensemble du personnel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

La laiterie coopérative
a été construite avec des
pierres de la carrière de Riçay. |
1898 : La beurrerie commence à fonctionner.
1899 : Les résultats sont encourageants. La
quantité de lait travaillé pour l'année atteint les 2.499.715 litres.
116.564 kilos de beurre ont pris la
direction des halles de Paris et ont été vendus pour la somme de 305.494
francs.
1900 : En l'espace de quatre ans, la
coopérative a plus que doublé son nombre de sociétaires, puisqu’ils sont
aujourd’hui 260. Les 2.000 vaches qui alimentent la laiterie sont en
grande partie des Parthenaises. Elles se nourrissent de foin, de choux, de
betteraves, de maïs, de trèfle et de luzerne. La production augmentant
sans cesse, un jeune homme, M. Marcel Pineau est embauché comme beurrier.
La laiterie est
agrandie à deux reprises en 1900 et 1906, vraisemblablement par le même
architecte. Il semblerait que l'établissement est l'un des premiers de la
région à être doté d'une machine frigorifique (en 1900). Il est à noter
que, sur le registre des adhésions, 14 % des agriculteurs ne savent pas
signer leur nom et se font soit représenter, soit apposent une croix en
guise de signature.
A
une date indéterminée, le constructeur "Dyle et Bacalan" installe un système réfrigérant (Hall.)
fonctionnant au CO2.
1905 : Le lait
arrive à profusion dans les bacs. Afin d'améliorer la qualité du lait et
de soulager dans ses fonctions M. Marcellin Aubineau, le
contrôleur-écrémeur entré en août de l'année dernière, on recrute au mois
de mai un autre contrôleur en la personne de M. Léonce Chamard.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L'excellent travail de tout le personnel
apporte les premières récompenses.
Parmi les nombreuses distinctions que les produits laitiers
saint-varentais ont mérité, celles rappelées ci-dessous confirment
l'intérêt des organisateurs des grandes foires et salons internationaux
pour les beurres et fromages de cette laiterie coopérative :
- médaille d'argent à l'Exposition universelle de 1900
- médaille d'or au Concours général agricole de Paris en 1901
- grand prix du Concours international à Bruxelles en 1904
- médaille
d'or pour ses beurres en mai 1905 à l'exposition de Liège (Belgique)
- médaille d'or au concours agricole de Paris 1906
Pendant ces douze mois, les 20 laitiers ont
apporté 5.831.938 litres qui ont produit 272 tonnes de beurre.
1906 : "Dramatique accident"
Le samedi 17 septembre, deux ouvriers d'une
entreprise privée posaient la charpente du nouveau bâtiment lorsque
soudain la maçonnerie s'écroula subitement . Les deux hommes chutèrent
lourdement d'une hauteur de 10m. Le médecin, arrivé sur les lieux,
diagnostiqua immédiatement la gravité des blessures. Atteints tous deux de
fractures diverses et surtout pour un d'une fracture du crâne, on les
transporta à l'hôpital de Thouars. Hélas le plus gravement atteint décéda
le lendemain.
M. Primault, le président-directeur, et M. Auguste
Chessé, le vice-président, furent terriblement
affectés par ce drame. Un affaissement du sol est à l'origine de
l'accident. |

La caséinerie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
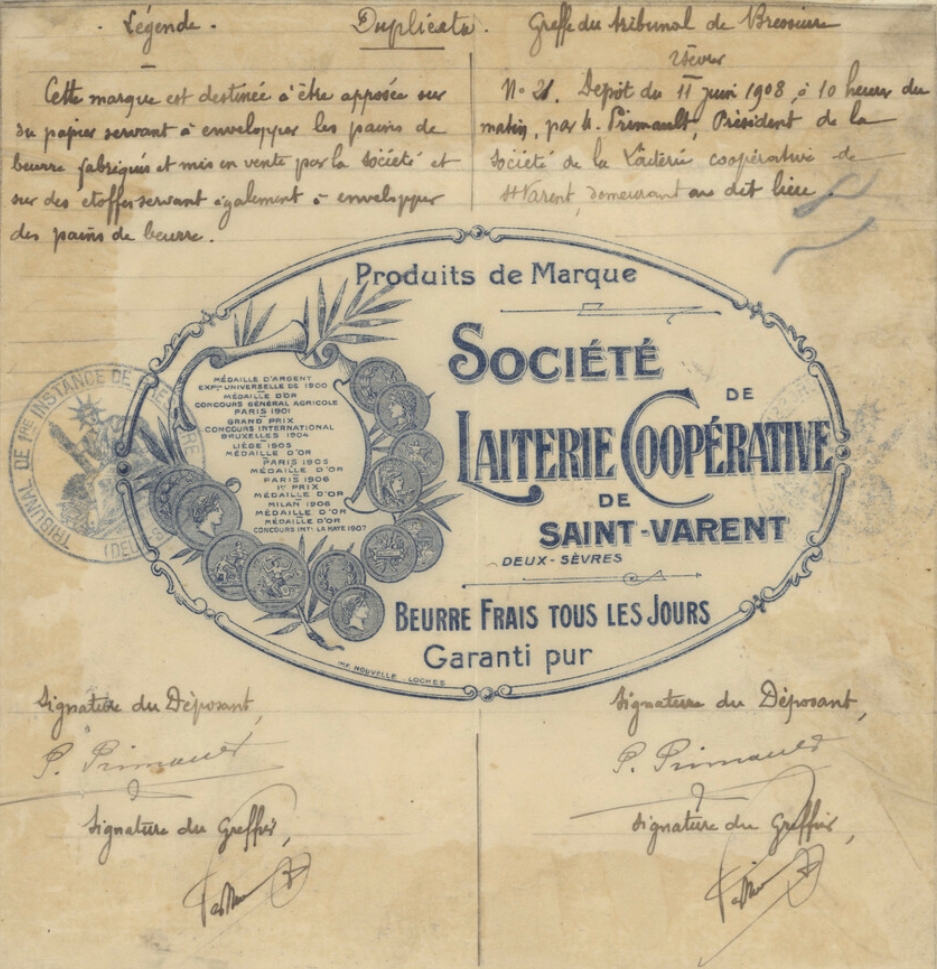
Dépôt de marque du 11 juin 1908 |
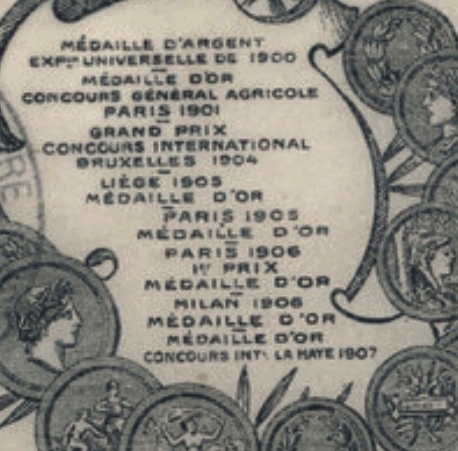
zoom sur les récompenses obtenues |
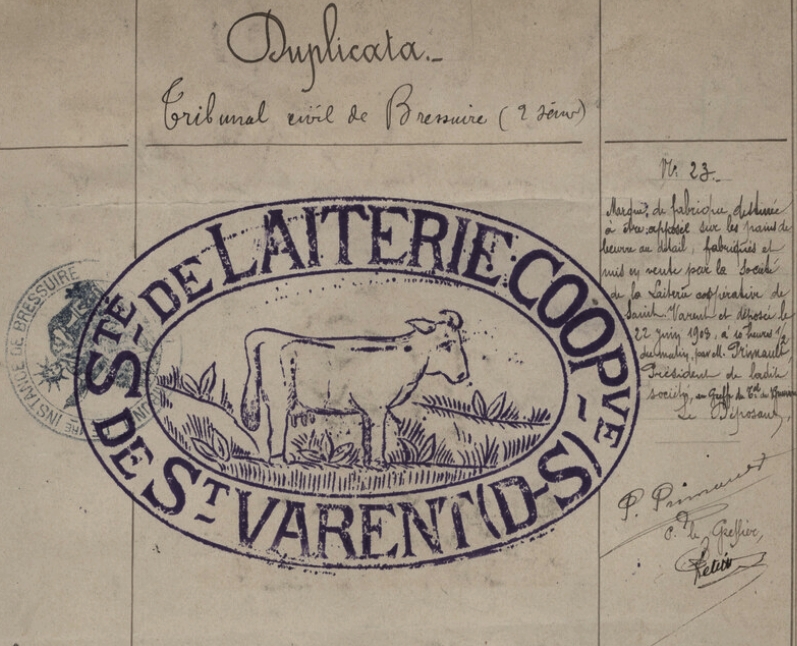
Dépôt de marque du 22 juin 1908 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1909 : La laiterie s'équipe d'un nouveau
malaxeur ''Hignette'', d'un réchauffeur. De nouveaux employés font leur
entrée : MM. Emile Bironneau, Auguste Migeon comme beurrier et Emile
Monbrun comme aide-beurrier.
1910 : La laiterie coopérative de
St-Varent a pris de l'ampleur depuis sa création. Pas moins de 23 laitiers
dont M. Clément Cron, sillonnent les chemins de cette vallée du Thouaret.
Dans un classement des laiteries des Deux-Sèvres, elle figure dans le trio
de tête. On peut constater que si St-Loup est la plus importante laiterie
du département en nombre de sociétaires et de vaches, St-Varent arrive en
tête dans la collecte de lait et en production beurrière. Par contre le
gros point noir pour ces deux laiteries concerne le rendement laitier.
Saint-Varent n'occupe que le 24ème rang avec 20,75 litres de lait pour
obtenir un kilo de beurre. St-Loup est encore plus loin en 32ème position
avec 24,4 litres.
M. Primault, le dévoué président-directeur
va s'attacher à convaincre les sociétaires à sélectionner leurs laitières
et d'adopter exclusivement la race Parthenaise (la meilleure beurrière en
ce moment) comme l'ont fait les laiteries qui obtiennent le meilleur
rendement laitier.
A cette époque est bâtie
une caséinerie par la Société coopérative de caséinerie de Saint-Varent,
cela permet à l'entreprise de valoriser la protéine du lait. Les
traitements de ces produits sont réalisés par l'Association des
caséineries de Surgères.
1911 : Une
porcherie est également édifiée. Après la transformation du lait, le lait
écrémé était retourné aux coopérateurs-éleveurs. Dorénavant
ce sérum est destiné à nourrir
des cochons. Des bâtiments spécifiques sont construits en 1911 et 1914
pour 1200 places, ce qui est nécessaire à l'engraissement de 3 000 porcs
charcutiers par an.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
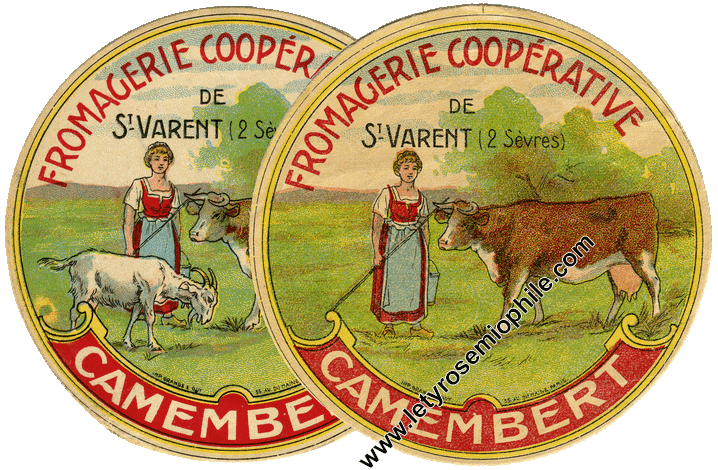
Les premiers fromages "camembert mi-chèvre"
et "camembert" datent des années 1910-1920 |
1914/1918 : Il faut pallier au départ des
hommes : Les laitiers MM. Paul Servant, Emile Archambaud ainsi qu'un
écrémeur M. Emile Macouin entrent à la laiterie.
1925 : Notre ami
Marcel Pineau fête ses 25 ans de services. De modeste employé à ses
débuts, il est parvenu au poste de chef-beurrier. La collecte annuelle se
monte à 6.459.894 litres qui ont donné 284.185 kg de beurre. Il a fallut 8
ans à la laiterie pour retrouver son niveau d'avant-guerre. |
|
|
|
|
|
|
|
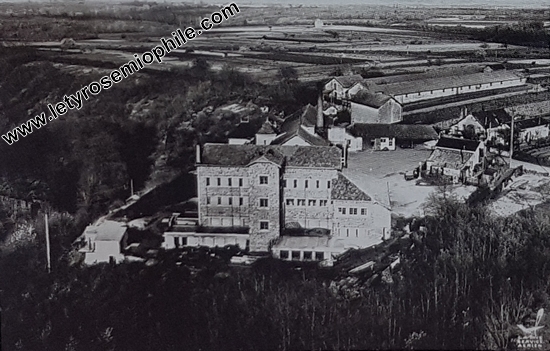
La laiterie et les porcheries en arrière
plan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1929
: Pendant près de 30 années consécutives, M. Primault
administra cette société qui, pour la qualité de son beurre, obtint une
très grande renommée, toujours maintenue par les apports constant de
perfectionnements modernes.
Le petit-fils de M. Primault,
M. René Mosnay,
lui succède, il conservera
cette responsabilité jusqu'à son décès en 1966.
Il arrive journellement à
la laiterie 25.000 litres de lait qui sont travaillés et servent à la
fabrication d'un beurre de table extra-fin, qui est ensuite expédié dans
toute la France et extrêmement apprécié des gourmets.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
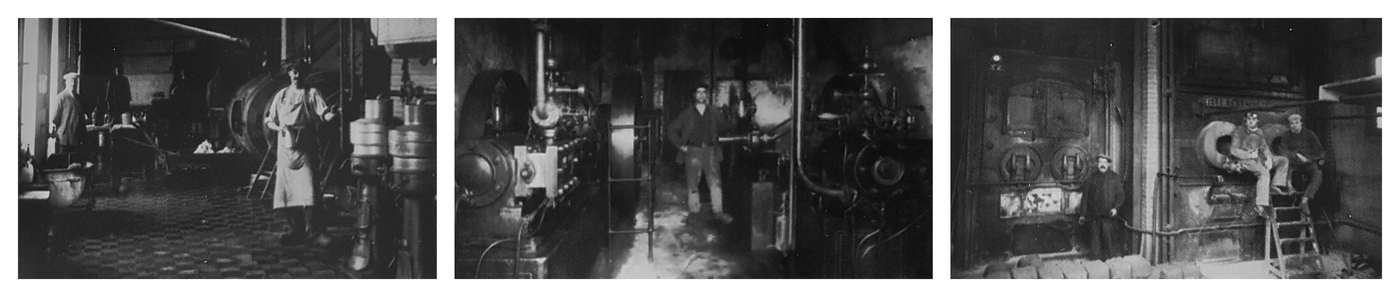
Les écrémeuses et les chaudières |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L'usine saint-varentaise
investit le plus souvent dans des machines à la pointe de la technique. Au
fil des ans, les évolutions sont maîtrisées. C'est ainsi que les avantages
liés à la gravitation, à l'énergie produite par la machine à vapeur ont
été utilisés à bon escient avant l'arrivée de l'électricité afin de
traiter le lait dans des conditions optimales.
1930 : La première tâche de Mr Mosnay
est la création d'une vraie fromagerie, même s'il semble que du fromage
ait déjà été fabriqué.
Voici une autre étape de la diversification des activités de la laiterie.
Les sociétaires s'orientent donc vers la production de fromages à pâte
molle de type camembert. Les techniques de fabrication des fromages à base
de lait de vache sont pratiquement les mêmes que celles à développer pour
produire des fromages de chèvre. La coopérative réussit aussi ce nouveau
challenge.
Le bâtiment qui
abrite l'atelier de fabrication des fromages et les salles d'affinage ne
sont construits que vers 1948.
L'Association Centrale des Laiteries Coopératives décerne un
diplôme d'Honneur à notre fidèle et inusable Marcel Pineau pour ses 30
années d'ancienneté.
La vente des produits
saint-varentais s'effectue sur toute la France. Chaque semaine, un wagon
frigorifique empli des beurres et fromages de la coopérative quitte la
gare locale pour être dirigé vers les halles de Paris. L'entreprise
exporte aussi une partie de sa production vers l'Allemagne.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
1935 : Les 7 millions de litres de lait
collecté dans l'année sont atteints. Un jeune contrôleur, M. Arsène
Couteault fait son entrée à la laiterie, suivi quelque mois plus tard par
M. Georges Morin à l'écrémage |
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
1940/1945 : Comme pour les autres, la
période n'est pas rose pour la laiterie et pour M. Mosnay, toujours à sa
tête. Parmi les 17 laitiers, on peut voir MM. : Loiseau, Ernest Gourdon,
Léopold Cousin. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
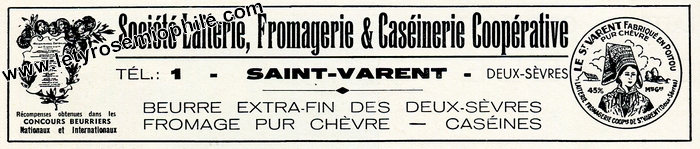
1954 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
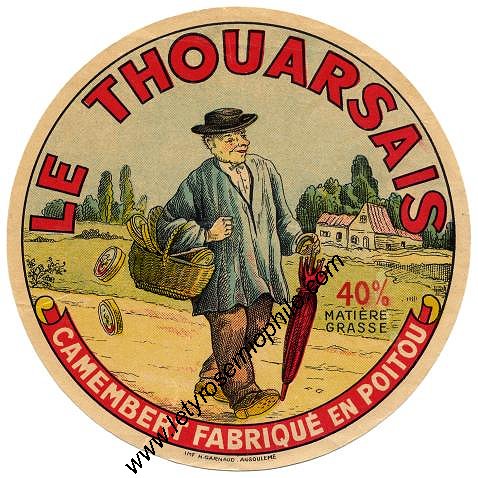 |
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1956 : La laiterie recueille dans ses
cuves, la quantité annuelle de 8.380.000 litres de lait. Les célèbres
camemberts "Le Thouaret'' et "Le Petit Gars" font la réputation de
St-Varent dans l'hexagone.
|
|
|
|
|
|

La laiterie coopérative en 1956.
|

Fromage Le Thouarsais |
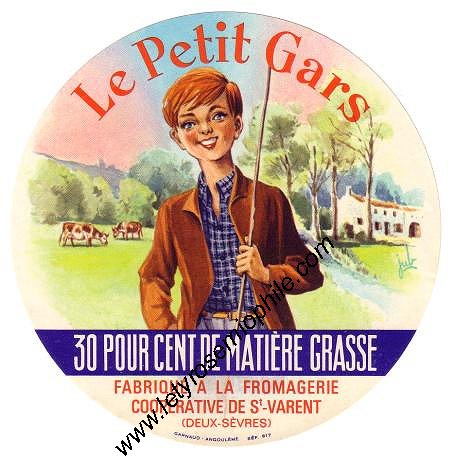
Fromage Le Petit Gars |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1957 : Pensant à sa succession, M. Mosnay
fait venir à ses cotés un jeune homme, M. Jean Thomas comme directeur
technique.
Les laitiers effectuent 18 tournées par
jour dont 5 en charrettes contenant des bidons de 100 et 120 litres. Ils
collectent chez 1.200 sociétaires dont 800 produisent du lait de vache et
le restant du lait de chèvre.
Ces ramasseurs, tous de solides
gaillards n'en sont pas moins de temps en temps de joyeux drilles, tel
le "légendaire "Raymond Leboeuf". Raymond à l'habitude de pousser un
grand coup de clairon lorsqu’il parvient en haut de la côte de
Pierrefitte. Aussitôt il met son cheval en travers de la route . Quand
on lui demande pourquoi fait-il cela, il répond : "mon gars, après une
escalade pareille il faut bien que le cheval et le bonhomme se
reposent un brin !" Quelques minutes après il repart. C'est un costaud
notre Raymond mais c'est aussi un vigneron, amateur certes, mais bien
au courant pour produire son vin. Quant à notre ami Ernest Gourdon,
qu'il fasse beau, qu'il pleuve où qu'il vente, il porte constamment
des pantoufles. "Faut croire que tu fréquentes des fermes qui ont des
cours carrelées !" comme lui disent ses collègues en riant.
Le 1er octobre, la laiterie de Taizé
fusionne avec St-Varent.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Les boites de fromage de Saint-Varent |
Les marques commerciales de
la coopérative :
Les différents types de
camemberts produits ont des taux variables de matières grasses en fonction
de la demande des clients : 25%, 30%, 40%, 45% et 50%.
Ils sont commercialisés
sous différentes marques et différentes formes : "Le Coquelicot", "La
Petite Frimousse", "Le Thouaret", "Le coq gaulois", "Le Thouarsais", "Le
petit gars".
Le conditionnement s'effectue dans des boîtes en
carton dont la bande est quelquefois complémentaire à l'étiquette pour
former un véritable écrin.
Il
existe aussi des portions de demi-camembert et même un fromage à la coupe.
Pour les productions à base de lait de chèvre, la marque est évidente : il
s'agit du fromage « Le Saint-Varent ».
|

La Petite Frimousse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dans les années 1960,
débute la production de poudre de lait dans un atelier construit à cet
effet. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1962 : La coopérative signe des accords
commerciaux avec sa voisine de Saint-Loup. Les relations entre les deux
présidents-directeurs, M. Mosnay et M. Perrault ont toujours été très
bonnes.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1966 : "Saint-Varent en deuil"
Le 6
Juin, on apprend le décès de M. Mosnay. Il fut, comme son grand-père, M.
Primault, comme MM. Eugène Perrault de St-Loup ou Delphin Sagot d'Echiré
et bien d'autres, de cette race d'hommes qui par leur persévérance et leur
travail ont réussi le but qu'ils se fixaient. Avec cette disparition, une
page de l'histoire de la coopérative laitière de St-Varent se tourne.
M. Merceron, ami de longue date de M. Mosnay accède à la présidence.
1967 : "La CARCO"
Dans le but de s'adapter pour mieux répondre aux attentes du marché et au
poids grandissant de la grande distribution, un vaste regroupement des
coopératives a été entrepris dans le Centre Ouest de la France.
Le 20 décembre marque la naissance de la Coopérative AgRicole du
Centre-Ouest (la CARCO) qui unit les laiteries coopératives
d'Argenton-l'Eglise,
Saint-Loup-Lamairé et St-Varent. Le siège social du groupe va être
St-Loup.
L'établissement de St-Varent
se voit confier la fabrication des camemberts pour le groupe et, dès lors,
la production de beurre et de caséine cesse. M. Thomas reste le
directeur de St-Varent.
1968 : La porcherie, créée en 1911,
longtemps fermée, rouvre ses portes.
1969 : En se voyant confier la fabrication
des camemberts par le groupe, la laiterie arrête progressivement la
production de la caséine et de beurre. Avec une collecte de lait de plus
de 10 millions de litres, ce sont 26.000 camemberts fabriqués
quotidiennement qui prennent, pour la plus grosse partie d'entre eux, la
direction de l'Allemagne. 65 employés composent l’ensemble du personnel de
l’entreprise.
1972 : La retraite arrive pour M. Arsène
Couteault après 37 ans de bons et loyaux services. M. René Rambaux l'a
remplacé au contrôle depuis quelque temps. La 4CH de René est célèbre à
St-Varent. Un jour en voulant reculer dans la cour de l'usine, la voiture
heurta une sorte de borne et se retourna. Notre cascadeur se retrouva dans
une position inconfortable.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1976 : Les difficultés financières de la
section lait de la CARCO, amènent les responsables de cette dernière à
fermer la laiterie de St-Varent. Il ne va pas y avoir de licenciement. Le
personnel va travailler à
Saint-Loup-Lamairé qui reste la seule entreprise du groupe.
Le 31 décembre, la laiterie coopérative
ferme la dernière page de sa glorieuse histoire. Elle restera encore
pendant deux années un centre de ramassage de lait. Les
bâtiments sont désaffectés, hormis les chambres froides servant de
stockage. La laiterie est à l'abandon aujourd'hui.
Voici quelques hommes qui ont compté et
veillé à la bonne marche de l'établissement.
M. René Jean, le chef de
la fromagerie, originaire du Bourdet.
M. Jacques Bocquier qui après
avoir été laborantin à la laiterie est responsable-adjoint de la laiterie
de St-Loup.
M. Daniel Dufour, l'adjoint de fabrication à la
fromagerie.
Et en premier chef, M. Jean Thomas dont voici le
parcours professionnel, riche en événements.
M. Jean Thomas, né en
1932 à La Mothe-St-Héray, entre à l'Ecole d'Industrie Laitière de Surgères
en Octobre 1952, dans la 9° Promotion. À sa sortie, son diplôme en poche,
il part comme contrôleur à la fromagerie Lepetit à Bretteville (Calvados).
Bientôt le service National l'appelle. Il fait ses 18 mois en Tunisie. A
son retour, il trouve au mois de mai 1955 un poste de laborantin à la
Laiterie des Fermiers Réunis (S. A. F. R) de Tourcoing (Nord). Au bout de
trois jours, il est promu chef-d'équipe puis plus tard contremaître. Il y
reste jusqu’en septembre 1957, après avoir pris pour épouse, au mois de
juin, une jeune fille de la région.
Le 1er octobre 1957, il entre à la
laiterie de St-Varent qu’il dirigera jusqu’à la fermeture le 31 décembre
1976. Il devient le lendemain et jusqu'en mars 1980 le directeur de la
Région Nord Deux-Sèvres de la Section Céréales de la CARCO dont le
président est M. Marcel Pouget. De
1980 à 1983, il seconde le Directeur-Général de la CARCO, M. Gausseres, au
siège à Niort. Il effectue avec M.
Gausseres, la liquidation de la CARCO.
Fin 1983, il effectue un stage à
Marcq-en-Baroeul(Nord). Le 6 février
1984, Il est nommé Directeur de Poitou-Oeuf à Maillé par Vouillé la
Bataille dans la Vienne. Le 31
décembre 1991, après la fermeture de la Société, il est mis en
pré-retraite. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rédaction et mise en page ED - © letyrosemiophile.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()